La zuppiera la soupière- Robert Lamoureaux – la chasse au canard : video
Ernesto Daranas da Los Dioses Rotos a Conducta
Condotta | Behavior di Ernesto Daranas Serrano (Anteprima)
Cuba, 2014, 108’, v.o.sott.it
Chala ha 11 anni e vive da solo con la madre alcolizzata e tossicodipendente. Alleva cani da combattimento per sopravvivere e questo mondo di violenza si ripercuote spesso nell’ambiente scolastico. Carmela è un’insegnante per la quale il ragazzo nutre affetto e rispetto, ma quando si ammala ed è costretta a rinunciare alla scuola per diversi mesi, l’inesperta supplente incapace di gestire Chala, lo invia a una scuola di Condotta. Al suo rientro, Carmela si oppone al provvedimento e ai vari cambiamenti subiti dalla sua classe. Il rapporto tra Chala e l’insegnante si rafforza ma tale situazione rischierà di compromettere la loro permanenza nella scuola.
http://www.casadelcinema.it/?event=condotta-behavior-di-ernesto-daranas-serrano
Ernesto Daranas, Director of Smash Hit ‘Conducta’ on Making Films in Cuba
This interview is part of our ongoing coverage of the Havana Film Festival in New York (HFFNY). Last night the festival opened with a screening of Conducta and continues through April 11.
Since its premiere last month in Cuba, HFFNY’s opening night film Conducta has turned into a virtually unprecedented social phenomenon. Hordes of devotees have packed theaters night after night and turned director Ernesto Daranas’ second feature into the hot topic at bus stops, bodega lines, and ocean-side drinking sessions. Critics have echoed public opinion, anointing Conducta as “the one;” the film the Cuban people have been waiting for since Tomás Gutiérrez Alea’s Oscar-nominated Fresa y Chocolate sent shock-waves through the island in the early 90s.
To give a little context, Cuban cinematic culture is like perhaps no other in Latin America. Cubans are fiercely proud of their national cinema and consistently flock to Havana’s crumbling theaters to see their peculiar reality reflected on the big screen in the latest work by directors such as Jorge Perugorría or the recently deceased Daniel Díaz Torres. But, underlying this rabid devotion has been the messianic promise that one day the film would come – the film that would capture Cuban social reality in all its complexity, that would give voice to their frustrations and anxieties while still offering some hope for the future. For the moment, it seems that film is Conducta.
Needless to say, this fanatical reception hasn’t been without its detractors. Any outpouring of sentiment on the level that’s been seen over the last few months in Havana is going to generate strong feelings on the contrary but luckily the Havana Film Festival New York has brought Conducta in all it’s glory to New York for local audiences to draw their own conclusions and get a privileged window into life on-the-ground in Old Havana.
Although he was not able to attend the New York premiere, I had the chance to catch up with Daranas in advance of Conducta’s opening night screening and ask him a little about his career, filmmaking in Cuba and, of course, Conducta.
What is your professional background? How did you end up making films?
I studied Geography but never practiced the profession. Before graduating I had already begun to write and direct for radio, theater and television. I came to film in 2008 thanks to a fund for low budget projects. That’s how I made my first film Los Dioses Rotos (Broken Gods).
Cuba is a country with a strong cinematic tradition. How do you think you fit within that?
The truth is, I’m not entirely sure. The two films I’ve made take place in the impoverished areas of Old Havana, which is the neighborhood where I’ve always lived. They are very personal themes for me and that determines how I approach the subject matter. But in general, I think Cuban cinema has shown a marked concern for social issues which has given us some of our most important works.
What do you think is the importance of film in a country like Cuba?
It’s almost impossible to conceive of a country without images that express it. Cuba is not an exception.
What specific challenges do you confront when producing a feature in Cuba?
Every possible challenge, but perhaps the most serious of them has to do with the absence of a film statute that structures, foments and defends our cinema in all of its aspects.
Could you talk about the process of fundraising for your first film, Los Dioses Rotos?
Los Dioses Rotos was a selected by the Ministry of Culture for a low budget film fund. In the actual execution of the project, the ICAIC (Cuban Film Institute) and Altavista Films became involved. The biggest difficulty we confronted had to do precisely with the lack of resources we had available.

After Los Dioses Rotos, what brought you to Conducta?
The same social concerns regarding the area where I live, this time having more to do with childhood and the role of the educator in impoverished areas. It started as a film workshop that I was able to share with a group of students from the film department at the Superior Institute of Art (ISA), and the creative exchange with them turned out to be very productive, as well as the exchange I had with the children who act in the film, neither of whom had previous acting experience.
Do you feel that there are new tendencies or a new generation of filmmakers that are coming of age in Cuba?
I think so. The important thing now is that they be given more opportunities to work and develop themselves professionally.
Conducta has turned into quite a social phenomenon in Cuba. Did you expect this type of reaction? How does it make you feel?
I didn’t expect it, at least not to this degree, and of course it makes us all very happy.
Now that Conducta is traveling – first to Guadalajara and now to New York – what hopes do you have for the future of the film?
It was really well received in Guadalajara and in Málaga we just won several prizes. These have been two really nice first steps that, beyond the prizes, tell us that the film can be shared with a broader audience. As for New York, we’re very happy that our principal actors and our casting director can be part of this festival.
Finally, what are your plans for the future?
Fight to make the stories that I’m interested in filming. Right now I’m prepping Pink Smoke, which is a somewhat zany comedy that flirts with the western and magical realism.
http://remezcla.com/film/ernesto-daranas-director-of-smash-hit-conducta-on-making-films-in-cuba/
Los Dioses Rotos
| Ficha TécnicaGuión: Ernesto Daranas Dirección: Ernesto Daranas Producción General: Manolo Angueira Dirección de Fotografía: Rigoberto Senarega Montaje o Edición: Pedro Suárez Música Original: Edesio AlejandroINTÉRPRETES Silvia Águila (Laura) Carlos Ever Fonseca (Alberto) (debutante) Ania Bu (Sandra) Héctor Noas (Rosendo) Isabel Santos (Isabel) Manuel Oña (Basilio) Patricio Wood (Román) Amarilys Núñez (Rosa) Mario Limonta (Lázaro) |
|
||
| SinopsisLaura (35 años) es una profesora universitaria que prepara su tesis de maestría sobre el famoso proxeneta cubano Alberto Yarini y Ponce de León, asesinado a balazos por sus rivales franceses que controlaban el negocio de la prostitución en La Habana de comienzos del siglo XX. Interesada en demostrar la vigencia del legendario personaje, descubre en su pesquisa sociológica un hecho para ella subyugante: En una de las casas de culto de La Habana, existe una prenda religiosa que atesora el pañuelo con el que Elena Morales -una de las meretrices de Yarini- intentó contener la hemorragia de su chulo la tarde de noviembre de 1910 en que los franceses lo balearon mortalmente. Para Laura, la revelación presenta un notable valor histórico con toda la dosis de “morbo” que un buen golpe investigativo exige, razón por la que se propone realizar un estudio comparativo del ADN de la sangre seca en el pañuelo con el de los restos de Yarini y, de ese modo, autentificar o desmentir la historia tejida en torno a la reliquia.
Por su parte, Alberto y Sandra (24 años) nos hablan de una juventud signada por su entorno social. Ella, saliendo de la cárcel; él, de regreso de París en el albor de su carrera como gigoló. No importa cuanto quieran huir de la realidad a la que se deben, el amor les une más allá de toda conveniencia y en el instante en el que esta historia los reencuentra tras dos años de distancia, Rosendo (40 años, temido proxeneta y propietario del pañuelo de Yarini) se levanta entre ellos como un obstáculo insuperable. Al centro de todo esto, Laura, que en su obsesión por la reliquia pasa por alto que a nadie más que a ella interesan tales evidencias. Inevitable será entonces que el escabroso mundo en que se adentra termine por volverse contra ella. Pero más allá de su anécdota, Los Dioses Rotos es una trama de valores enfrentados; una reflexión en torno a perspectiva ética y moral de un grupo de personajes -de todos los niveles socioculturales- entre quienes los clichés de “positivos” y “negativos” no resultan sencillos de etiquetar. Drama social, suspense y melodrama comulgan en una historia interesada en resultar amena, universal y consecuente con la realidad a la que se debe. |
|||
| Premios Premio del Público en el 30 Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. 2008. Premios de la Crítica Cinematográfica y de la Crítica Cultural cubanas en el 30 Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. 2008. Premio Mejor Maqueta de Largometraje (ex aequo). 6º Festival Internacional de Cine Pobre, Gibara, 2008. Seleccionada por la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica entre las 10 mejores películas exhibidas en el año, 2008. Premio Caricato al Mejor Actor en Cine a Héctor Noas. Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 2009. Premio de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Premio mejor dirección de arte a Erick Grass. 17 Providence Latin American Film Festival. Estados Unidos, 2009. Premio mejor música a José Antonio Leyva y Magda Rosa Galván. 17 Providence Latin American Film Festival. Estados Unidos, 2009. |
|||
| Comentarios La realidad que “es” y no la que quisiéramos (Resumen) Los dioses rotos Ernesto Daranas sin etiquetas Los dioses en llamas, pero las emociones, enteras (Resumen) Los dioses rotos (resumen) Los dioses…y otro reconocimiento Yarini o la caida de los dioses menores (Resumen) Los dioses rotos: “Bajo presupuesto criollo” (Publicado en: Revista Cine Cubano #167) Melodrama, suspenso y tragedia en nueva película cubana (Resumen) Al fin Los dioses… estrenados (Resumen) El arte se destruye cuando deja de tocar a la gente a la que se debe Entrevista a Ernesto Daranas, guionista y director de Los dioses rotos Los dioses rotos, el mayor acontecimiento audiovisual en Cuba de los últimos tiempos ¿Dioses rotos? Impenitente celebración de buen cine Entrevista a Héctor Noas, “Rosendo” en Los dioses rotos |
|||
Arresti in Vaticano, manette ; la mia signora la conoscevo bene : vecchi post, sono cinefila…
La lobby di Dio : libro di Ferruccio Pinotti
Opus Dei: Il Capitalismo di dio | controappuntoblog.org
IOR: BELLA FREGATA! e correlati di vecchi post + la dolce …
Opus Dei. Il segreto dei soldi. Dentro i misteri dell’ omicidio Roveraro
IOR, una lunga storia e Quando il banchiere di Dio divenne ‘uomo morto’
ALLA RICERCA DI FELLINI: Roma (prima parte) – Federico
Fontana di Trevi riapre – storia della fontana di Trevi
- 04 Nov 2015 14.37
La fontana di Trevi riapre dopo il restauro
La fontana di Trevi è stata riaperta a Roma dopo 17 mesi di restauro. I lavori, costati due milioni e 180mila euro, sono stati finanziati dalla casa di moda Fendi. Nella serata di martedì, 3 novembre, si è tenuta una cerimonia in cui la fontana, libera da recinzioni e impalcature e dotata di una nuova illuminazione, è stata riempita d’acqua.
L’amministratore delegato di Fendi, Pietro Beccari, ha annunciato che la società restaurerà altre quattro fontane della capitale: quella del Gianicolo, la fontana del Mosè, il Ninfeo al Pincio e la fontana del Peschiera.
http://www.internazionale.it/video/2015/11/04/roma-fontana-trevi-inaugurazione-immagini
La fontana di Trevi è una fontana imponente eretta come terminazione e mostra celebrativa del restauro di un antico acquedotto romano.
L’acquedotto è l’acquedotto Vergine, costruito da Marco Vipsanio Agrippa intorno al 19 a.C.: Agrippa era il genero e generale favorito dell’ Imperatore Ottaviano Augusto, nonchè esperto architetto, lo stesso citato nell’iscrizione famosa sul Pantheon. L’acquedotto era lungo 21 km di cui 19 erano sotterranei.
L’acquedotto fu costruito da Agrippa per rifornire le Terme Pubbliche in Campo Marzio da lui volute e completate. Già allora fu eretta una grande fontana nel punto in cui il condotto terminava. Tale fontana sorgeva pressappoco dove ore si trova la Chiesa di S. Ignazio.
Secondo il libro specialistico di Sesto Giulio Frontino “De aquaductibus Romae commentarius”, l’acquedotto prese il suo nome da una vergine fanciulla che i soldati romani incontrarono in un momento in cui erano stanchi ed assetati. Ella li guidò verso una fonte d’acqua per rifocillarsi. Tale sorgente si trovava nell’Ager Locullanus, un terreno tra la Via Tiburtina e la via Collatina, due delle “strade che portano a Roma”. Quella fonte ancora oggi fornisce l’acquedotto.
Nel IV secolo vi erano a Roma 1352 fontane (Notitia dignitatum imperii Romani).
L’acquedotto fu danneggiato dalle invasioni degli Ostrogoti guidati dal re Vitige nel 537. Dopo le conquiste barbariche una lunga parte dell’acquedotto fu abbandonata e tutti i restauri di epoca medievale interessarono i tratti fino all’incrocio del trivium senza continuare oltre verso Via Lata.
Agli inizi del Rinascimento i Papi cominciarono a decorare le terminazioni degli acquedotti che restaurarono con maestose e ricche fontane.
Clicca qui per la pagina successiva sulla storia della fontana…
Napoli = Milano : Stazioni centrali, ucciso pianoforte ; Galimberti post….
 Troppo bello per durare, il pianoforte all’interno della Stazione Centrale di Napoli. Lo strumento a disposizione di tutti, che da mesi veniva suonato da musicisti e viaggiatori, è stato vandalizzato e reso inutilizzabile.
Troppo bello per durare, il pianoforte all’interno della Stazione Centrale di Napoli. Lo strumento a disposizione di tutti, che da mesi veniva suonato da musicisti e viaggiatori, è stato vandalizzato e reso inutilizzabile.
A scoprirlo, ieri, dei fan di Laura Pausini, che si erano dati appuntamento alla stazione per un flash mob dedicato alla cantante.
Pianoforti simili sono stati installati anche a Roma, Torino e Milano. Anche nel capoluogo lombardo lo strumento è stato danneggiato, sebbene non irreparabilmente come accaduto invece a piazza Garibaldi.
http://avvocata.napolitoday.it/mercato/distrutto-pianoforte-stazione-centrale-garibaldi.html
Devastato dai vandali ancora una volta il piano in Stazione centrale
Da inizio agosto è transennato, con ammaccature e martelletti distrutti: “Non oso pensare che desse fastidio”, scrive sconsolato un lettore
http://www.milanotoday.it/cronaca/pianoforte-transennato-stazione-centrale.html
Umberto Galimberti: La doppia vita (integrale 2015) -Follia …
Umberto Galimberti: “Il segreto della domanda
Umberto Galimberti – Idee: il catalogo è questo . L’ospite ..
neuroni specchio: imitazione, comprensione, condivisione
Estinzione dell’inconscio? Una recente mutazione antropologica …
Le funzioni cognitive sono localizzate nella corteccia cerebrale …
il ribaltamento del paradigma di Freud. – controappuntoblog ..
Fisiologia e stoicismo ne «Le passioni dell’anima» di Cartesio
Per una nuova possibilità etica: l’apertura all’alterità …
Umberto Galimberti: “Il segreto della domanda .
Umberto Galimberti – Il tramonto dell’Occidente .
Bolobene e Bolofeccia non sono i ragazzi della via Paal ..
Pouvoirs De Vie, Pouvoirs De Mort: Introduction a Une …
Umberto Galimberti: “Il segreto della domanda …
Ragazzo seviziato in fin di vita a Napoli ; Umberto …
Morti e ferite: Umberto Galimberti da Mimmo Mirachi blog .
FATTORI INNATI E FATTORI APPRESI NELLA PERCEZIONE – Sta scherzando Mr. Feynman!
New analysis finds human language to be one million years old (Video) + video neuroscienza, CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
La parola ci fa uguali – Lettera a una professoressa ..
libro e film del giorno pdf e Telechargement : UNA STORIA SEMPLICE …Trasimaco
L. Sciascia: Una storia semplice
Una storia semplice – France Telechargement
Una storia semplice
Letteratura italiana
Editore
http://www.qlibri.it/narrativa-italiana/racconti/una-storia-semplice/
Leonardo Sciascia: A ciascuno il suo.pdf, audio libro, films …
Amianto: Cassazione su Eternit; Trasimaco, Cefalo , la lunga vita dell’Asbesto
Carrione, quell’argine di polistirolo :vari post stato mafia …
Leonardo Sciascia e il cretino | controappuntoblog.org
Morte dell’inquisitore Leonardo Sciascia ; I professionisti …
IL GIORNO DELLA CIVETTA COME ROMANZO POLIZIESCO …
Gesualdo Bufalino : Diceria dell’untore – l’amaro miele …
Il Consiglio d’Egitto – Leonardo Sciascia – il film : Leonardo Sciascia ..
Todo modo | controappuntoblog.org
Il cavaliere e la morte di Leonardo Sciascia .
Diceria dell’untore – controappuntoblog.org
Leonardo Sciascia Il Mare Colore Del Vino free – Il lungo .
mondo di mezzo : “il morto è morto, diamo aiuto al vivo”: DA ..
in Italia i termini esatti li usa solo la mafia ; mondo di mezzo .
Trasimaco, La giustizia è l’utile del più forte …
Roland Barthes mostra a Torino – Mythologies full pdf
Mythologies
Mythologies (9780374521509): Roland Barthes, Annette …
In mostra le 50 prime edizioni italiane delle opere di Roland Barthes
di Redazione Il Libraio | 04.11.2015
Capace di comprendere nelle sue esplorazioni i testi della letteratura come gli oggetti del consumo quotidiano, la lingua dei classici come quella dei contemporanei, Roland Barthes, figura capitale per la critica e la letteratura per tutta la seconda metà del Novecento, ha avuto sulle cose uno sguardo onnivoro e mai quieto. E ora arriva una mostra a Torino…
Il 12 novembre 1915, a Cherbourg, nasceva Roland Barthes, figura capitale per la critica e la letteratura per tutta la seconda metà del Novecento, tutt’ora stampato, letto, studiato e amato. Fra i suoi titoli Frammenti di un discorso amoroso, Miti d’oggi e L’impero dei segni (Einaudi). Capace di comprendere nelle sue esplorazioni i testi della letteratura come gli oggetti del consumo quotidiano, la lingua dei classici come quella dei contemporanei, ha avuto sulle cose uno sguardo onnivoro e mai quieto.
A chiusura del centenario, “FN mostra Barthes” intende celebrarlo esponendo a Torino la sua intera produzione e raccogliendo, per la prima volta assieme, tutte le prime edizioni italiane cartacee, da Il grado zero della scrittura (Lerici, 1960) a Il discorso amoroso (Mimesis, 2015), 50 volumi di 21 editori diversi. Saranno anche esposte decine di volumi di edizioni differenti, ristampe e opere che contengono testi di Barthes. La grafica della mostra è a cura di Christel Martinod.
La mostra, aperta in via Giuseppe Baretti 31 a Torino dal 6 all’8 novembre, a cura di Federico Novaro e Marco Mondino, è un’iniziativa di FN, progetto trasversale di cultura e critica editoriale, e intende essere una significativa testimonianza di un pezzo di cultura e di editoria italiana attraverso la materialità delle sue testimonianze cartacee.
Durante la serata sarà in vendita il catalogo autopubblicato della mostra, con tutte le schede bibliografiche, le foto delle prime edizioni e un’introduzione di Mondino. I ricavati della vendita serviranno come autofinanziamento per FN, che ha organizzato l’evento senza finanziamenti o sponsor.
L’attenzione che FN dedica a Barthes è di lunga data: dal 2013, infatti, ha aperto una sezione di approfondimento sulla sua opera a cura di Marco Mondino, il Bar Barthes. Da quell’esperienza, ancora in corso, è nata “FN mostra Barthes”, la prima mostra organizzata da FN (una seconda è prevista per gennaio a Zara, all’Istituto di Cultura Italiano, sulla collana Prosa contemporanea di Guanda, a cura di Mauro Maraschi).
Il rapporto fra smaterializzazione dei testi e materialità dei libri cartacei è uno dei campi di indagine del sito, le mostre sono un’occasione per fare storia e critica editoriale intorno a episodi nodali della cultura del Novacento.
http://www.illibraio.it/mostra-prime-edizioni-roland-barthes-262460/
Roland Barthes - Miti d’oggi – Einaudi, Torino 1994
Mythologies - Seuil, Paris 1970
Per presentare questo libro non ho trovato nulla di meglio che riportare alcune annotazioni del suo autore tratte dalle poche righe in apertura vergate nel febbraio 1970, e dall’avant- propos, che traduco dall’originale volumetto comprato in una bancarella di Parigi (Mythologies, Edition du Seuil, 1970).
«I testi di Mythologies sono stati scritti tra il 1954 e il 1956; il libro è uscito nel 1957. Vi si troveranno qui due propositi: da un lato una critica ideologica condotta sul linguaggio della cultura detta di massa; dall’altro un primo smontaggio semiologico di questo linguaggio: avevo appena letto Saussure e ne avevo tratto la convinzione che trattando le “rappresentazioni collettive” come dei sistemi di segni si poteva sperare di uscire dalla denuncia spicciola e rendere conto in dettaglio della mistificazione che trasforma la cultura piccolo-borghese in natura universale». «Tentai allora di riflettere regolarmente su qualche mito della vita quotidiana francese. La materia di questa riflessione era di vario tipo (un articolo di giornale, una foto di un settimanale, un film, uno spettacolo, una mostra), e il soggetto piuttosto arbitrario: si trattava evidentemente della mia attualità.
L’inizio di questa riflessione, era il più sovente un sentimento di impazienza di fronte al “naturale” di cui la stampa, l’arte, il senso comune rivestono senza posa una realtà che, per essere quella in cui viviamo, non è meno strettamente storica: in una parola, soffrivo nel vedere in ogni momento confuse nel racconto della nostra attualità, Natura e Storia, e volevo cogliere nell’esposizione decorativa del fatto-spontaneo , l’abuso ideologico che a parer mio, vi si trova nascosto.
La nozione di mito m’è parsa fin dall’inizio meglio lumeggiare queste false evidenze; intendevo allora il termine nel suo significato tradizionale. Ma ero già convinto di una cosa di cui tentai in seguito di trarne tutte le conseguenze: il mito è un linguaggio ».
Già da queste parole, scritte come sempre nella forma elegante di un principe delle lettere francesi che allora faceva i suoi primi passi (Il grado zero della scrittura era uscito quattro anni prima) si comprende l’intonazione a sua volta ideologica, o meglio dire contro-ideologica, di questo delizioso libretto. Il testo di Barthes è infatti assoggettato non solo a delle preoccupazioni che per brevità definiamo scientifiche, e il cui carico è sostenuto dalla semiologia confinata a mo’ di postfazione nei saggi finali, ma anche, e soprattutto direi, dalle intenzioni di critica culturale a carattere militante poggianti sul processo di smitizzazione cui sottopone l’idéologie anonime della piccola borghesia. Questa demistificante carica polemica è già tutta in Marx (Il manifesto, L’ideologia tedesca). S’è discusso a tal proposito se con il termine mythologie Barthes non traduca piuttosto la nozione di ideologia di conio filosofico tedesco e marxiano. Barthes estende il concetto se non il termine all’attualità e alla società francesi con un metodo che ancora oggi sarebbe fecondo se applicato con intelligenza, e con una verve come la sua che è rimasta insuperata.
Se volessimo averne una traduzione in termini italiani ci piacerebbe che tale metodo ad esempio venisse applicato, col dovuto voltaggio espressivo, alla società italiana qui ed ora, alla critica televisiva, al giornalismo di costume, alla cronaca di tutti i giorni. Un Porta a porta analizzato con gli strumenti di Barthes, ma anche un Ballarò, un TG3 e un TG1, una gara di Formula Uno col suo carrozzone di briatori e montezemoli, un ritratto di Don Gelmini, una sfilata di moda, un articolo del Corriere e uno di Repubblica: insomma l’operazione di smontaggio semiologico a favore di una verità che risulterebbe non già eterna a valevole per tutte le teste, ma che semplicemente fosse il frutto di questa raspata sulla vernice con la quale ci viene offerto il fatto sociale, culturale, di spettacolo, ovvero l’”oggetto culturale”, come lo chiamava Barthes, il quale di un tipo umano ci dà l’archetipo e di un fatto il noumeno per dirla in termini alti ed eccessivi, ossia la sua vera essenza a luogo del fenomeno, della rappresentazione.
Qualcosa delle atmosfere di questo libro ha già agito tuttavia nel nostro panorama culturale. Per fare un esempio l’intellettuale che ogni tanto tenta analisi à la Barthes è a mio avviso Aldo Grasso, il critico televisivo del Corriere, ma l’accenno al fenomeno ci fa sovvenire anche il testo italiano che forse più risentì della lezione barthesiana ossia Diario minimo di Umberto Eco (dove è accolta una celebre Fenomenologia di Mike Buongiorno) e certamente anche Nuovi riti nuovi miti, il bel libro di Gillo Dorfles di cui si è persa traccia nei cataloghi Einaudi e recentemente pubblicato da Skira. Potrei aggiungere che non è difficile rintracciare in alcuni approcci di Barthes – l’attenzione verso i fatti della cultura popolare ad esempio-, alcuni tratti stilistici, se non alcune preoccupazioni, come quella di ricostruire l’ideologia piccolo-borghese, che furono di Antonio Gramsci. Al pensatore sardo toccò occuparsi della letteratura popolare trattando di Carolina Invernizio e dei superuomini da portineria nel registrare la ricezione popolaresca di Nietzsche con intenti di Kulturkritik, che non è difficile rintracciare anche in questi testi di Barthes, che certamente non conosceva Gramsci. Mentre, d’altra parte, certune risonanze di questo libro sono presenti in alcuni Scritti corsari di Pasolini (l’articolo sui jeans Jesus o quello sui capelloni senza dubbio).
Certo, il libro reca anche le tracce dell’air du temps in cui fu scritto, la Francia degli anni ‘50 e l’Europa divisa dai due blocchi ideologici che si sono sciolti solo con la caduta del muro di Berlino. Certe impostazioni ideologiche (tra Sartre e Brecht) fanno irrigidire alcune annotazioni culturali: ad esempio salta fuori una critica implicita, seppur coperta da grandi lodi di Charlie Chaplin, il quale dandoci nei suoi film il povero e non il proletario situerebbe il suo uomo-Charlot «al di sotto della presa di coscienza politica» mentre «la sua anarchia, discutibile politicamente, rappresenta in arte la forma forse la più efficace della rivoluzione». Insomma un «Non è dei nostri, però è grande ugualmente», che mi sembra un virgolettato eccessivo per il geniale Chaplin.
Ma Mythologies è memorabile soprattutto per quei saggi lampeggianti della prima parte di cui potremmo dire subito che irretisce l’approccio stilistico, quella sproporzione sicuramente intenzionale, e che ne è anzi una componente essenziale – il proprio di questo libro-, tra la strumentazione retorica dell’osservatore e l’innocenza (che dopo averla scorta sotto la luce dell’autore diventa però subito apparente), dei fatti osservati: una gara ciclistica, un incontro di catch, un articolo della stampa femminile, il congresso mondiale dei produttori di detersivi, l’iconografia dell’Abbé Pierre, il matrimonio della regina Elisabetta, etc, e gli echi che in termini di scrittura o di immagini registrano tutti questi eventi sulla carta stampata. Barthes spara con un bazooka contro il menomo “oggetto culturale” allo scopo di farne deflagrare tutto il senso latente, come faceva Rimbaud con le semplici vocali di cui avrebbe detto tutte le loro naissances latentes. Ed ecco che un incontro di catch denuncia sistemi culturali e universi mentali totalmente differenti, visto che in America questo sport figura come una sorta di combattimento mitologico tra il Bene e il Male di natura parapolitica essendo ritenuto il cattivo sempre un Rosso (lo schema resisterà fino agli anni 70 coi film della serie di Rocky), mentre in Francia subisce tutt’altro processo di eroicizzazione, d’ordine etico e non più politico: «Ciò che il pubblico vi cerca qui , è la costruzione progressiva di un’immagine eminentemente morale: quella del farabutto perfetto. Si viene al catch per assistere alle avventure rinnovate di un archetipo, personaggio unico, permanente e multiforme come Guignol o Scapin, calato in figure inattese e tuttavia sempre fedeli alla propria funzione », insomma qualcosa che rimanda a La Bruyère o a Molière. Anche il Tour de France gli appare sotto questa luce da Comèdie Française come «il mondo delle essenze caratteriali», mentre il viso della Garbo «rappresenta quel momento fragile dove il cinema tira una bellezza esistenziale da una bellezza essenziale, dove l’archetipo inclina verso il fascino ambiguo di figure perenti, dove la luminosità delle essenze carnali cede il posto a una lirica della donna». Archetipi, ma anche segni. Il diavolo si nasconde nei dettagli, e il fine semiologo riconosce il dinosauro dall’ossicino di Cuvier. Così l’eccesso di parrucche nel film Giulio Cesare di Mankiewicz racchiude nell’artificialità hollywoodiana delle frangette tutta una romanità posticcia, poiché «il segno funziona in eccesso, si discredita facendo apparire la sua finalità». E l’abbé Pierre è invece una «foresta di segni» fatta di barba, sandali e della chierica che raggiunge «l’archetipo capillare della santità» e forse diventa l’alibi con il quale la Francia sostituisce impunemente «i segni della carità con la realtà della giustizia».
Siamo nella Francia degli anni ’50, gli anni in cui trionfa Poujade e il poujadisme, ossia il movimento dei bottegai, dei borghesi piccoli piccoli, che odiano con la stessa virulenza sia il fisco che gli intellettuali. Sono un po’ come i nostri leghisti senza la componente etnica e padana, i nostri qualunquisti di Guglielmo Giannini del dopoguerra. Verso di loro Barthes lancia le sue frecce più velenose e acuminate: in fondo quando dice “piccolo borghese” è a Poujade che si rivolge, è lui l’interlocutore esplicito, e la sua “ideologia anonima” – bella espressione in cui viene racchiusa tutto il “pensiero” della piccola borghesia- è il bersaglio della prosa di Barthes. Una componente di questa ideologia anonima è l’odio per il mondo delle parole degli intellettuali, della loro ricchezza semantica: da qui il ricorso alla tautologia che denuncia l’ insofferenza per le spiegazioni articolate. Ma insomma, che sarà mai il teatro: “il teatro è il teatro” dice il piccolo borghese, e Barthes chiosa acidamente: «la pigrizia promossa al rango del rigore : “Racine è Racine”: sicurezza ammirabile del niente». E precisa: «C’è nella tautologia un doppio omicidio: si uccide la razionalità perché vi resiste; e si uccide il linguaggio perché vi tradisce». In questo mondo morale accade che ogni parola avversa è ridotta a un rumore e in cui l’abilità polemica del borghese piccolo piccolo consiste nel «caricare l’avversario degli effetti delle proprie mancanze, a chiamare oscurità la propria cecità e inconsistenza verbale la propria sordità». «Ogni antintellettualismo finisce nella morte del linguaggio, ossia nella distruzione della socialità» poiché «il piccolo borghese è un uomo incapace di immaginare l’Altro».
Nella seconda parte “Le mythe, aujourd’hui” il nostro corrosivo critico sistematizza il suo pensiero, costruisce una teoria. Ma non so riassumerla: troppo ricca di dottrina. Il vostro lettore piccolo piccolo è ancora intontito dalla potenza stilistica e dalla stordente bellezza saggistica della prima parte e si ritiene già sazio. Cosa sarà mai una teoria semiologica? Una teoria è una teoria, dopotutto.
Alfio Squillaci
http://lafrusta.homestead.com/rec_barthes.html
roland-barthes : L’impero dei segni – Le plaisir du texte ..
film del giorno : L’ora di religione – fulll e clip
L’ora di religione – Il sorriso di mia madre Streamin
Sergio Castellitto nella parte del pittore Ernesto Picciafuoco, un agnostico dalla personalità tormentata. L’artista viene a sapere da un prete che la propria madre sarà beatificata. Il fatto è clamoroso e non sarebbe davvero oppurtuno che una futura santa risultasse madre di un non credente. Altri problemi arrivano anche dal figlio di Ernesto, che non vuole essere discriminato a scuola e decide di frequentare l’ora di religione.
Bellocchio penetra l’animo umano rigoroso e formalmente perfetto, anche se una volta aveva più energia. Per un autore vero le stelle di valutazione non possono mai essere meno di tre.
http://www.mymovies.it/film/2002/loradireligioneilsorrisodimiamadre/
Arresti in Vaticano, manette ; la mia signora la conoscevo bene : vecchi post, sono cinefila…
libro e film del giorno pdf e Telechargement : UNA STORIA SEMPLICE …Trasimaco
La Cina è vicina : Marco Bellocchio | controappuntoblog.org
Mostra del Cinema di Venezia: quest’anno al Lido si porta la .
Boule de Suif (Guy de Maupassant) – texte intégral italiano e francese ; films da Maupassant
Boule de Suif (Guy de Maupassant) – texte intégral ..
Palla di sego di Maupassant – audio in italiano e francese e .
Etude d’oeuvre : Boule de suif de Maupassant (1880)
https://schoolstorming.wordpress.com/2012/05/31/palla-di-sego-maupassant/
Una metafora della società: “Palla di sego”, la storia di una prostituta raccontata da Guy de Maupassant
1880. Guy de Maupassant scrive uno dei suoi capolavori, un racconto che è una grande lezione di scrittura e un’attenta riflessione sulla miseria e sulla debolezza umana: “Boule de Suid” ( tradotto in italiano Palla di Sego ). L’opera nasce da una richiesta di Zola, che propone agli scrittori del suo gruppo di elaborare un racconto sull’invasione prussiana a Parigi. Le novelle ( tra cui quella dello stesso Zola ), sono confluite nella raccolta “Soirées de Médan”.
Il racconto narra la storia di dieci persone in fuga da Rouen, invasa dai prussiani, su una carrozza diretta a Dieppe: tre coppie di coniugi – specchio di diverse classi sociali ( commercianti, ricchi borghesi, nobili ) -, un rivoluzionario repubblicano, due suore e una procace prostituta, “Palla di sego”, inizialmente, mal tollerata e disprezzata dal gruppo.
In seguito a una forte nevicata, tuttavia, la carrozza è costretta a procedere a rilento e l’unica che ha con sé cose da bere e da mangiare è proprio la ragazza, mentre gli altri sono presi dalla fame. L’uno dopo l’altro, pur di nutrirsi, passano sopra le proprie convinzioni e i propri pregiudizi e si servono senza vergogna dal cesto in cui Palla di sego aveva le sue provviste.
In seguito, la protagonista torna in primo piano: la diligenza viene arrestata da un ufficiale prussiano che minaccia di non lasciar ripartire nessuno se Palla di sego non gli avesse concesso le sue grazie. Pur avendole concesse già a molti, la ragazza rifiuta sdegnata, animata da un vivo e reale spirito patriottico. Inizialmente appoggiata dai suoi compagni d’avventura, con il passare dei giorni, di fronte alla prospettiva di veder interrotto il loro tragitto, i viaggiatori rimproverano a Palla di sego di star nuocendo a tutti per un suo capriccio e tra varie insistenze e giocando con ricatti morali, la spingono a cedere.
A malincuore e per giovare a tutti, essa accetta. La carrozza può così ripartire; a quel punto, però, i viaggiatori ricominciano a guardare con disprezzo la sciagurata ragazza che si è prostituita per il bene comune, ed ecco che di nuovo Palla di sego torna a essere emarginata quando tutto rientra nella normalità.
Un racconto, in fondo, senza tempo. Uno specchio vivo e reale di quello che succede quotidianamente, della nostra società. L’autore segue con lucidità le speranze, le illusioni e le successive disillusioni della giovane donna. I confini tra il bene e il male ci appaiono ipocriti e insensati; prepotentemente i piccolo borghesi che abitano la carrozza si siedono dalla parte dei buoni e lasciano dal lato opposto una ragazza che per vivere usa il suo corpo, ma che ha energia, ideali e altruismo da vendere. L’iniziale illusione di poter entrare a far parte della schiera dei “giusti” è seguita da una brusca ricaduta, Palla di sego torna a essere una reietta. Eppure il nostro autore lascia parlare i fatti: non è la posizione sociale, il lavoro che troppe volte – per necessità – ci si trova a svolgere…non è il privilegio di nascita, il conto in banca, la casa, gli abiti, gli oggetti…sono altre le cose che qualificano una persona! I cosiddetti “giusti”, spesso, sono più meschini e ipocriti, decisamente più deplorevoli e detestabili di coloro che sono costretti a viaggiare sulla corsia opposta.
Guy de Maupassant: “Una Vita” Un affresco pessimista .
la collana e la rosa : Guy de Maupassant, Luigi Pirandello
Guy de Maupassant, Bel-Ami | controappuntoblog.org
LA REMPAILLEUSE, la rimpagliatrice : Guy de Maupassant
La signora Battista
http://www.controappuntoblog.org/2012/01/13/la-signora-battista/
J’aime la nuit avec passion. Nuit de neige : Guy de Maupassant
La Nuit : Guy de Maupassant : Free Download & Streaming
Consulter la version texte de ce livre audio.
J’aime la nuit avec passion. Je l’aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d’un amour instinctif, profond, invincible. Je l’aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l’air bleu, dans l’air chaud, dans l’air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l’espace noir, et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre.
Le jour me fatigue et m’ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m’habille avec lassitude, je sors avec regret, et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, chaque pensée me fatigue comme si je soulevais un écrasant fardeau.
Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m’envahit. Je m’éveille, je m’anime. A mesure que l’ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s’épaissir, la grande ombre douce tombée du ciel : elle noie la ville, comme une onde insaisissable et impénétrable, elle cache, efface, détruit les couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher.
Alors j’ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats ; et un impétueux, un invincible désir d’aimer s’allume dans mes veines.
Je vais, je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j’entends rôder mes soeurs les bêtes et mes frères les braconniers.
Ce qu’on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m’arrive ? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est. – Voilà.
Donc hier – était-ce hier ? – oui, sans doute, à moins que ce soit auparavant, un autre jour, un autre mois, une autre année – je ne sais pas. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s’est plus levé, puisque le soleil n’a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle ? Depuis quand ?… Qui le dira ? Qui le saura jamais ?
Donc hier, je sortis comme je fais tous les soirs, après mon dîner. Il faisait très beau, très doux, très chaud. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d’étoiles découpé dans le ciel par les toits de la rue qui tournait et faisait onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres.
Tout était clair dans l’air léger, depuis les planètes jusqu’aux becs de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses. Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil.
Sur le boulevard, les cafés flamboyaient ; on riait, on passait, on buvait. J’entrai au théâtre, quelques instants, dans quel théâtre, je ne sais plus. Il y faisait si clair que cela m’attrista et je ressortis le coeur un peu assombri par ce choc de lumière brutale sur les ors du balcon, par le scintillement factice du lustre énorme de cristal, par la barrière de feu de la rampe, par la mélancolie de cette clarté fausse et crue. Je gagnai les Champs-Elysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d’incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l’air peints, un air d’arbres phosphorescents. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des oeufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale les filets de gaz, de vilain gaz sale, et les guirlandes de verres de couleur.
Je m’arrêtai sous l’Arc de Triomphe pour regarder l’avenue, la longue et admirable avenue étoilée, allant vers Paris entre deux lignes de feux, et les astres ! Les astres, là-haut, les astres inconnus jetés au hasard dans l’immensité où ils dessinent ces figures bizarres, qui font tant rêver, qui font tant songer.
J’entrai dans le Bois de Boulogne et j’y restai longtemps, longtemps. Un frisson singulier m’avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie.
Je marchai longtemps, longtemps. Puis je revins.
Quelle heure était-il quand je repassais sous l’Arc de Triomphe ? Je ne sais pas. La ville s’endormait, et des nuages, de gros nuages noirs s’étendaient lentement sur le ciel.
Pour la première fois je sentis qu’il allait arriver quelque chose d’étrange, de nouveau. Il me sembla qu’il faisait froid, que l’air s’épaississait, que la nuit, ma nuit bien-aimée, devenait lourde sur mon coeur. L’avenue était déserte maintenant. Seuls, deux sergents de ville se promenaient auprès de la station des fiacres, et sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants, une file de voitures de légumes allait aux Halles. Elles allaient lentement, chargées de carottes, de navets et de choux. Les conducteurs dormaient, invisibles, les chevaux marchaient d’un pas égal, suivant la voiture précédente, sans bruit, sur le pavé de bois. Devant chaque lumière du trottoir, les carottes s’éclairaient en rouge, les navets s’éclairaient en blanc, les choux s’éclairaient en vert ; et elles passaient l’une derrière l’autre, ces voitures rouges, d’un rouge de feu, blanches d’un blanc d’argent, vertes d’un vert d’émeraude. Je les suivis, puis je tournai par la rue Royale et revins sur les boulevards. Plus personne, plus de cafés éclairés, quelques attardés seulement qui se hâtaient. Je n’avais jamais vu Paris aussi mort, aussi désert. Je tirai ma montre. Il était deux heures.
Une force me poussait, un besoin de marcher. J’allai donc jusqu’à la Bastille. Là je m’aperçus que je n’avais jamais vu une nuit si sombre, car je ne distinguais pas même la colonne de Juillet, dont le Génie d’or était perdu dans l’impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l’immensité avait noyé les étoiles, et semblait s’abaisser sur la terre pour l’anéantir.
Je revins. Il n’y avait plus personne autour de moi. Place du Château-d’Eau, pourtant, un ivrogne faillit me heurter, puis il disparut. J’entendis quelque temps son pas inégal et sonore. J’allais. A la hauteur du faubourg Montmartre un fiacre passa, descendant vers la Seine. Je l’appelai. Le cocher ne répondit pas. Une femme rôdait près de la rue Drouot : « Monsieur, écoutez donc. » Je hâtai le pas pour éviter sa main tendue. Puis plus rien. Devant le Vaudeville un chiffonnier fouillait le ruisseau. Sa petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandai : « Quelle heure est-il, mon brave ? »
Il grogna : « Est-ce que je sais. J’ai pas de montre. »
Alors je m’aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints. Je sais qu’on les supprime de bonne heure, avant le jour, en cette saison, par économie ; mais le jour était encore loin, si loin de paraître.
« Allons aux Halles, pensai-je, là au moins je trouverai de la vie. »
Je me mis en route, mais je n’y voyais pas même pour me conduire.
J’avançais lentement, comme on fait dans un bois, reconnaissant les rues en les comptant.
Devant le Crédit Lyonnais, un chien grogna. Je tournai par la rue de Grammont, je me perdis ; j’errai, puis je reconnus la Bourse aux grilles de fer qui l’entourent. Paris entier dormait, d’un sommeil profond, effrayant. Au loin pourtant un fiacre roulait, un seul fiacre, celui peut-être qui avait passé devant moi tout à l’heure. Je cherchais à le joindre, allant vers le bruit de ses roues, à travers les rues solitaires et noires, noires, noires comme la mort.
Je me perdis encore. Où étais-je ? Quelle folie d’éteindre si tôt le gaz ! Pas un passant, pas un attardé, pas un rôdeur, pas un miaulement de chat amoureux. Rien.
Où donc étaient les sergents de ville ? Je me dis : « Je vais crier, ils viendront. » Je criai. Personne ne me répondit.
J’appelai plus fort. Ma voix s’envola, sans écho, faible, étouffée, écrasée par la nuit, par cette nuit impénétrable.
Je hurlai : « Au secours ! au secours ! au secours ! »
Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc ? Je tirai ma montre, mais je n’avais point d’allumettes. J’écoutai le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre. J’étais moins seul. Quel mystère ! Je me remis en marche comme un aveugle, en tâtant les murs de ma canne, et je levais à tout moment les yeux vers le ciel, espérant que le jour allait enfin paraître ; mais l’espace était noir, tout noir, plus profondément noir que la ville.
Quelle heure pouvait-il être ? Je marchais, me semblait-il, depuis un temps infini, car mes jambes fléchissaient sous moi, ma poitrine haletait, et je souffrais de la faim horriblement. Je me décidai à sonner à la première porte cochère. Je tirai le bouton de cuivre, et le timbre tinta dans la maison sonore ; il tinta étrangement comme si ce bruit vibrant eût été seul dans cette maison.
J’attendis, on ne répondit pas, on n’ouvrit point la porte. Je sonnai de nouveau ; j’attendis encore, – rien !
J’eus peur ! je courus à la demeure suivante, et vingt fois de suite je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge. Mais il ne s’éveilla pas – et j’allai plus loin, tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons, heurtant de mes pieds, de ma canne et de mes mais les portes obstinément closes.
Et tout à coup, je m’aperçus que j’arrivais aux Halles. Les Halles étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une botte de légumes ou de fleurs. – Elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes !
Une épouvante me saisit – horrible. Que se passait-il ? Oh ! mon Dieu ! que se passait-il ?
Je repartis. Mais l’heure ? l’heure ? qui me dirait l’heure ? Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensai : « Je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l’aiguille avec mes doigts. » Je tirai ma montre… elle ne battait plus… elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l’air. Rien ! plus rien ! plus même le roulement lointain du fiacre – plus rien !
J’étais aux quais, et une fraîcheur glaciale montait de la rivière.
La Seine coulait-elle encore ?
Je voulus savoir, je trouvai l’escalier, je descendis… Je n’entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont… Des marches encore… puis du sable… de la vase… puis de l’eau… j’y trempai mon bras… elle coulait… elle coulait… froide… froide… froide… presque gelée… presque tarie… presque morte.
Et je sentais bien que je n’aurais plus jamais la force de remonter… et que j’allais mourir là… moi aussi, de faim – de fatigue – et de froid.
Nuit de neige
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.
Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.
Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ;
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.
La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.
De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.
Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ;
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.
Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.
Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;
De leur oeil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.
Guy de Maupassant, Des vers
La grande pianura è bianca, immobile e senza voce.
Non un rumore, non un suono; tutta la vita è scomparsa.
Ma a volte si sentono, come un triste lamento
Cani senza riparo urlare all’angolo di un bosco.
Non più canti nell’aria, nè stoppie sotto i nostri piedi.
L’inverno è sceso su tutta la fioritura;
Alberi spogli all’orizzonte alzano
I loro scheletri bianchi come fantasmi.
La luna è grande e pallida e sembra affrettarsi.
Sembra che abbia freddo nel grande cielo austero.
Il suo sguardo spento percorre la terra,
E vedendo tutto deserto, si affretta a lasciarci.
E freddi cadono su di noi i raggi che scaglia,
Barlumi fantastici va seminando;
E la neve si illumina, sinistramente,
Con strani riflessi di livida luce.
Oh! che notte terribile per gli uccellini!
Un vento gelido attraversa di brividi i viali;
Essi, non avendo più l’asilo ombroso di un giaciglio
Non possono dormire sulle zampe congelate.
Nei grandi alberi spogli coperti dal ghiaccio
Sono lì, tremanti, con niente a proteggerli;
Dai loro occhi guardano inquieti la neve
Attendendo fino all’alba la notte che non arriva mai.
Boule de Suif (Guy de Maupassant) – texte intégral italiano e francese ; films da Maupassant
Guy de Maupassant: “Una Vita” Un affresco pessimista .
la collana e la rosa : Guy de Maupassant, Luigi Pirandello
Guy de Maupassant, Bel-Ami | controappuntoblog.org
LA REMPAILLEUSE, la rimpagliatrice : Guy de Maupassant
La signora Battista
http://www.controappuntoblog.org/2012/01/13/la-signora-battista/
“Je vois Satan tomber comme l’éclair” , See Satan Fall: ” René GIRARD ed altro
 René Girard ( Avignone, 25 dicembre 1923 – Stanford, 4 novembre 2015
René Girard ( Avignone, 25 dicembre 1923 – Stanford, 4 novembre 2015
I See Satan Fall: Amazon.co.uk: Rene Girard
“Je vois Satan tomber comme l’éclair” René GIRARD
Né en 1923, membre de l ‘Académie Française, ancien élève de l’Ecole des Chartes et professeur émérite de littérature comparée aux Etats Unis. Il possède un doctorat d’histoire. Il publiera de nombreux ouvrages et ouvrira la voie à des découvertes scientifiques et à une pensée originale et percutante.
René GIRARD par l’analyse des textes bibliques et chrétiens et par la description des mythes, souhaite démontrer une réalité, des processus, des mécanismes, tels que :
-la notion de scandale,
-la violence mimétique, le désir mimétique,
-le sacrifice, le meurtre fondateur,
-le bouc émissaire,
-Satan,
-la Croix,
-la façon de considérer les victimes.
Comprendre tout cela, c’est selon l’auteur essayer de rompre le cycle du mal, le cycle de Satan, rupture déjà opérée par le symbole a temporel de la Croix. Que l’on soit athée, croyant, agnostique, le travail de René GIRARD est remarquable et ouvre des réflexions et des compréhensions que pour ma part je n’avais pas entrevues.
La nature mythique des Evangiles sera-t-elle un jour démontrée « scientifiquement » ?
R.G. : « non seulement cela n’est pas certain, mais il est certain que cela n’est pas. L’assimilation des textes bibliques et chrétiens à des mythes est une erreur facile à réfuter. Le caractère irréductible de la différence judéo-chrétienne peut être démontré. C’est cette démonstration qui fait l’essentiel du présent livre.
Mon raisonnement porte sur des données purement humaines, il relève de l’anthropologie du religieux et non pas de la théologie. Malheureusement ni les sociologues, qui se détournent systématiquement des Evangiles, ni paradoxalement les théologiens, toujours prédisposés en faveur de quelque vision philosophique de l’homme, n’ont l’esprit libre pour soupçonner l’importance anthropologique du processus dégagé par les Evangiles, l’emballement mimétique contre une victime unique.
Si la Croix démystifie toute mythologie plus efficacement que les automobiles et l’électricité de Bultmann, si elle nous débarrasse d’illusions qui se prolongent indéfiniment dans nos philosophies et nos sciences sociales, nous ne pouvons pas nous passer d’elle. Loin d’être à jamais démodée et dépassée, la religion de la Croix, dans son intégralité est cette perle de grand prix dont l’acquisition justifie plus que jamais, le sacrifice de tout ce que nous possédons.
Le savoir Biblique de la violence.
Le législateur qui interdit le désir des biens du prochain s’efforce de résoudre le problème numéro un de toute communauté humaine : la violence interne.
(Problème que nos politiques semble minorer pour des raisons idéologiques)
Pour penser que les interdits culturels sont inutiles, comme le répètent sans trop réfléchir les démagogues de la « modernité », il faut adhérer à l’individualisme le plus outrancier celui qui suppose l’autonomie totale des individus, c’est-à-dire l’autonomie de leurs désirs. Il faut penser en d’autres termes que les hommes sont naturellement enclins à ne pas désirer les biens du prochain.
On croit que le désir est objectif ou subjectif mais en réalité, il repose sur un autrui qui valorise les objets, le tiers le plus proche, le prochain. Pour maintenir la paix entre les hommes, il faut définir l’interdit en fonction de cette redoutable constatation : le prochain est le modèle de nos désirs. C’est ce que j’appelle le désir mimétique.
Les conflits inextricables qui résultent de notre double idolâtrie (du prochain et de nous-même) sont la source principale de la violence humaine. C’est pour couper court à tout cela que le Lévitique contient le commandement fameux : « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c’est –à-dire tu ne l’aimeras ni plus ni moins que toi-même.
Si on cessait de désirer les biens du prochain, on ne se rendrait jamais coupable ni de meurtre, ni d’adultère, ni de vol, ni de faux témoignage. S le dixième commandement était respecté, il rendrait superflus les quatre commandements qui le précèdent. Le but de la loi c’est la paix entre les hommes. Jésus ne méprise jamais la loi, même lorsqu’elle prend la forme des interdits. A la différence des penseurs modernes, il sait très bien que, pour empêcher les conflits, il faut commencer par les interdits.
Plus nous sommes « orgueilleux » et « égoïstes », plus nous nous asservissons aux modèles qui nous écrasent. Le désir mimétique nous fait échapper à l’animalité. Il est responsable en nous du meilleur comme du pire, de ce qui nous abaisse au-dessous de l’animal aussi bien que de ce qui nous élève au-dessus de lui. Nos discordes interminables sont la rançon de notre liberté. Les mots qui désignent la rivalité mimétique et ses conséquences sont le substantif skandalon et le verbe skansalizein.
Le cycle de la violence mimétique.
Il n’y a rien dans les Evangiles pour suggérer que Dieu est la cause du rassemblement contre Jésus. Ce qui motive Pilate lorsqu’il livre Jésus, c’est la peur d’une émeute. Il fait preuve dit-on, « d’habileté politique ». Sans doute mais pourquoi l’habileté politique consiste-t-elle presque toujours à s’abandonner au mimétisme collectif ? (voilà encore un fait très visible dans l’information quotidienne)
Ce qui détermine la puissance d’attraction des scandales, c’est le nombre et le prestige de ceux qu’ils réussissent à scandaliser. Les petits scandales ont tendance à se fondre dans les plus grands et les plus grands à leur tour, vont se contaminer mutuellement jusqu’à ce que les plus forts absobent les plus faibles. Il y a un concurrence mimétique des scandales qui se poursuit jusqu’au moment où le scandale le plus polarisateur reste seul en scène. A ce moment-là toute la communauté est mobilisé contre un seul et même individu. Les scandales entre individus sont les petits ruisseaux qui se fondent dans les grandes rivières de la violence collective. Ce que nous découvrons dans les Evangiles aussi bien dans la mort de Jean Baptiste que dans celle de Jésus, c’est un processus cyclique de désordre et de remise en ordre qui culmine et s’achève dans un mécanisme d’unanimité victimaire. J’emploie le mot « mécanisme » pour signifier la nature automatique du processus et de ses résultats, ainsi que l’incompréhension et même l’inconscience des participants.
Satan
Parce qu’il désire lui-même ce qu’il nous pousse à désirer, notre modèle s’oppose à notre désir. Les grandes crises débouchent sur le vrai mystère de Satan, sur son pouvoir le plus étonnant qui est celui de s’expulser lui-même et de ramener l’ordre dans les communautés humaines. C’est ce pouvoir extraordinaire qui fait de Satan le Prince de ce monde. S’il ne pouvait pas protéger son domaine des entreprises qui menacent de l’anéantir, et qui sont essentiellement les siennes, il ne mériterait pas ce titre de Prince que les Evangiles ne lui décernent pas à la légère.
La formule de Jésus : « Satan expulse Satan » à un sens précis, rationnellement explicable. C’est l’efficacité du mécanisme victimaire qu’elle définit. A ceux qui se définissent comme ses disciples, Jésus soutient que leur père n’est ni Abraham ? ni Dieu ? Comme ils l’affirment mais le diable. La raison de ce jugement est claire. Ces gens ont le diable pour père parce que ce sont les désirs du diable qu’ils veulent accomplir et non pas les désirs de Dieu. Ils prennent le diable comme modèle de leurs désirs.
La notion de cycle mimétique et de mécanisme victimaire donnent un contenu concret à une idée de Simone WEIL selon laquelle, avant même d’être une théorie de Dieu, une théologie, les Evangiles sont une théorie de l’homme » une anthropologie. Dans les Evangiles les phénomènes mimétiques et victimaires peuvent s’organiser à partir de deux notions différentes : le scandale et Satan.
L’énigme des mythes résolus.
Suite à une épidémie les Ephésiens s’adressèrent à APPOLONIUS DE TYANE pour les aider. Ci-dessous les récits que l’on peut trouver dans le livre de PHILOSTRATE « la vie d’APPOLONIUS DE TYANE ».
APPOLONIUS : « aujourd’hui je vais mettre fin à l’épidémie qui vous accable ».
Sur ces mots il conduisit le peuple entier au théâtre où une image du dieu protecteur était dressée. Il vit là une espèce de mendiant qui clignait des yeux comme s’il était aveugle et qui portait une bourse contenant une croûte de pain. L’homme, vêtu de haillons, avait quelque chose de repoussant. Disposant les Ephésiens en cercle autour de celui-ci, APPOLONIUS leur dit : « ramassez autant de pierres que vous pourrez et jetez-les sur cet ennemi des Dieux ». Les Ephésiens se demandaient où il voulait en venir. Ils se scandalisaient à l’idée de tuer un inconnu manifestement misérable qui les priait et les suppliait d’avoir pitié de lui. Revenant à la charge, APPOLONIUS poussait les Ephésiens à se jeter sur lui, à l’empêcher de s’éloigner.
Dès que certains d’entre eux suivirent ce conseil et se mirent à jeter des pierres au mendiant, lui que ses yeux clignotants faisaient paraître aveugle leur jeta soudain un regard perçant et montra des yeux pleins de feu. Les Ephésiens reconnurent alors qu’ils avaient à faire à un démon et le lapidèrent de si bon cœur que leurs pierres formèrent un grand tumulus autour de son corps.
Après un petit moment, APPOLONIUS les invita à enlever les pierres et à reconnaître l’animal sauvage qu’ils avaient mis à mort. Une fois qu’ils eurent dégagé la créature sur laquelle ils avaient lancé leurs projectiles, ils constatèrent que ce n’était pas le mendiant. A sa place, il y avait une bête qui ressemblait à un molosse, mais aussi grosse que le plus gros lion. Elle était là sous leurs yeux, réduite par leurs pierres à l’état de bouillie et vomissant de l’écume à la façon des chiens enragés. En raison de quoi, on dressa la statue du dieu protecteur, HERACLES, à l’endroit même où le mauvais esprit avit été expulsé ».
La lapidation est un mécanisme victimaire, tout comme la Passion et plus efficace encore que la Passion, sous le rapport de la violence, puisqu’il est tout à fait unanime et que la communauté se croit aussitôt débarrassée de son « épidémie de peste”.
Le symbolisme de la première pierre reste intelligible parce que même si le geste physique de la lapidation n’est plus là, la définition mimétique des comportements collectifs reste aussi valable qu’il y a 2000 ans. Pour favoriser la violence collective, il faut renforcer son inconscience, et c’est ce que fait APPOLONIUS. Pour décourager au contraire cette même violence, il faut faire sur elle la lumière, il faut respecter toute la vérité. C’est ce que fait Jésus.
La Croix est l’équivalent de la lapidation d’Ephèse. Ce processus doit être caractéristique des mythes en général, des mêmes groupes humains qui expulsent et massacrent les individus vers lesquels les soupçons convergent, mimétiquement, se mettent à les adorer lorsqu’ils se découvrent apaisés, réconciliés.
Pourquoi les Evangiles, dans leur définition la plus complète du cycle mimétique, recourent-ils à un personnage nommé Satan ou le Diable, plutôt qu’à un principe impersonnel ? La raison principale, je pense, c’est que le vrai manipulateur du processus, le sujet de la structure dans le cycle mimétique, n’est pas le sujet humain qui ne repère pas le processus circulaire dans lequel il est pris, mais bien le mimétisme lui-même. Il n’y a pas de vrai sujet en dehors du mimétisme et c’est cela que signifie en fin de compte le titre de prince de ce monde reconnu à cette absence d’être qu’est Satan.
Sacrifice.
Les mythes proprement dits font partie de la même famille textuelle que la lapidation d’APPOLONIUS, les phénomènes médiévaux de chasse aux sorcières ou encore…la Passion du Christ. Les sacrifices sont destinés : 1) à plaire aux dieux qui les ont enseignés aux hommes et 2) à consolider ou à restaurer, si besoin est, l’ordre et la paix dans la communauté.
Le meurtre fondateur.
Si on examine les grands récits d’origine et les mythes fondateurs on s’aperçoit qu’ils proclament eux-mêmes le rôle fondamental et fondateur de la victime unique et de son meurtre unanime. L’idée est partout présente. La doctrine du meurtre fondateur n’est pas seulement mythique mais biblique. Comme l’observe James WILLIAM « le signe de CAIN » est le signe de la civilisation. C’est le signe du meurtrier protégé par Dieu. Sous le rapport des rites, on peut distinguer grosso-modo trois types de sociétés. Il y a d’abord une société où le rite n’est plus rien ou presque plus rien et c’est la société contemporaine, notre société. Il y a ensuite ou plutôt il y avait naguère des sociétés où le rite accompagne en quelque sorte redouble toutes les institutions. C’est là que le rituel semble sur ajouté à des institutions qui n’ont pas besoin de lui. Les sociétés antiques et, en un autre sens, la société médiévale relèvent de ce type. C’est ce type faussement conçu comme universel par le rationalisme qui a suggéré la thèse du religieux parasitaire. Il y a enfin les sociétés « très archaïques » et qui n’ont pas d’institutions dans notre sens mais qui ont des rites. Elles n’ont pas d’autres institutions que les rites.
Les puissances et les principautés.
Le système des puissances, avec Satan derrière lui, est un phénomène matériel, positif et simultanément spirituel, religieux en un sens très particulier, à la fois efficace et illusoire. C’est le religieux mensonger qui protège les hommes de la violence et du chaos par l’intermédiaire des rites sacrificiels.
Le triomphe de la Croix.
S’il n’y a que des différences entre les religions, elles ne font plus qu’une seule et vaste indifférenciation. On ne peut plus dire vraies ou fausses qu’on ne peut dire vrais ou faux un conte de FLAUBERT ou un conte de MAUPASSANT . Ce sont deux œuvres de fiction et tenir l’une des deux pour plus vraie que l’autre serait absurde. La nature systématique de l’opposition entre le mythe et le récit biblique suggère que ce dernier obéît à une inspiration anti mythologique. Et cette inspiration révèle sur les mythes, quelque chose d’essentiel qui reste invisible en dehors de la perspective adoptée par le récit biblique. Les mythes condamnent toujours toutes les victimes isolées et universellement accablées. Ils sont l’œuvre de foules surexcités incapables de repérer et de critiquer leur propre tendance à expulser et massacrer les êtres sans défense, des boucs émissaires qu’ils tiennent toujours pour coupables des mêmes crimes stéréotypés, parricides, incestes, fornification bestiale et autres méfaits horrifiques et la récurrence perpétuelle et invraisemblable dénonce l’absurdité.
Le récit biblique condamne la tendance générale des mythes à justifier les violences collectives, la nature accusatrice, vindicative de la mythologie. Dans l’univers biblique les hommes sont aussi violents en règle générale que dans les univers mythiques et les mécanismes victimaires abondant ce qui diffère en revanche, c’est la Bible, dont l’interprétation biblique de ces phénomènes/
L’inversion du rapport d’innocence et de culpabilité entre victimes et bourreaux est la pierre d’angle de l’inspiration biblique. L’unanimité dans les groupes humains est rarement porteuse de vérité, elle n’est le plus souvent qu’un phénomène mimétique tyrannique.
Singularité des Evangiles.
Les divinations mythiques s’expliquent très bien, nous l’avons vu, par l’opération du cycle mimétique. Elles reposent sur l’aptitude des victimes à polariser la violence, à fournir aux conflits l’abcès de fixation qui les résorbe et les apaise. Si le transfert qui démonise la victime est très puissant, la réconciliation est si soudaine et parfaite qu’elle paraît miraculeuse et suscite un second transfert qui la superpose au premier, le transfert de divination mythologique.
Les Evangiles révèlent donc la vérité pleine et entière sur la genèse des mythes, sur la puissance d’illusion des emballements mimétiques, sur tout ce que les mythes forcément ne révèlent pas puisqu’ils en sont toujours les dupes. « Ils m’ont trahi sans raison » (Ps.35, 19). Banale en apparence, cette phrase exprime la nature essentielle de l’hostilité contre la victime. Elle est sans raison, précisément parce qu’elle est le fruit d’une contagion mimétique plutôt que de motifs rationnels, ou même d’un sentiment vrai chez les individus qui la ressentent.
Le triomphe de la Croix.
Avant le Christ l’accusation satanique était toujours victorieuse en vertu de la contagion violente qui enfermait les hommes dans les systèmes mythico-rituels. La croix fait triompher la vérité car, dans les récits évangéliques, la fausseté de l’accusation est révélée, l’imposture de Satan ou, ce qui revient au même, celle des principautés et des puissances est à jamais discréditée dans le sillage de la crucifixion. Ce qu’il faut retenir ici dans l’idée du triomphe ce n’est pas l’aspect militaire, c’est l’idée d’un spectacle offert à tous les hommes, c’est l’exhibition publique de ce que l’ennemi aurait dû dissimuler afin de se protéger, afin de persévérer dans son être que lui dérobe la croix. En privant le mécanisme victimaire des ténèbres dont il doit s’entourer pour gouverner toutes choses, la Croix bouleverse le monde. Sa lumière prive de son pouvoir principal celui d’expulser Satan. Une fois que ce soleil noir sera tout entier éclairé par la croix, il ne pourra plus limiter sa capacité de destruction. Satan détruira son royaume et il se détruira lui-même.
En nous permettant d’accéder à l’intelligence du mécanisme victimaire et des cycles mimétiques, les récits de la Passion permettent aux hommes de repérer leur prison invisible et de comprendre leur besoin de rédemption.
Bouc émissaire.
La vraie source des substitutions victimaires c’est l’appétit de violence qui s’éveille chez les hommes lorsque la colère les saisit et lorsque, pour une raison ou pour une autre, l’objet réel de cette colère est intouchable. « N’allez pas croire que je suis venu pour apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour ennemie les gens de sa famille (Mt. 10, 34-16). D’un univers privé de protections sacrificielles, les rivalités mimétiques se font souvent moins violentes mais s’insinuent jusque dans les rapports les plus intimes. C’est ce qui explique le détail du texte que je viens de citer : le fils en guerre contre son père, la fille contre sa mère, etc…Ses rapports les plus intimes se transforment en oppositions symétriques, en rapports de double, de jumeaux ennemis. Ce texte nous permet de repérer la vraie genèse de ce qu’on appelle la psychologie moderne.
Le souci moderne des victimes.
Un examen un tant soit peu attentif montre que tout ce qu’on peut dire contre notre monde est vrai : il est de très loin le pire de tous. Aucun monde, on le répète sans cesse et ce n’est pas faux, n’a jamais fait plus de victimes que lui. Mais les propositions les plus opposées sont toutes également vraies à son sujet : notre monde est aussi et de très loin le meilleur des mondes, celui qui sauve le plus de victimes. Il nous contraint à multiplier toutes sortes de propositions incompatibles les unes avec les autres.
Inventer l’hôpital c’est dissocier pour la première fois la notion de victime de toute appartenance concrète, c’est inventer la notion moderne de victime. Dans ce qu’on appelle aujourd’hui les « droits de l’homme » l’essentiel est une compréhension du fait que tout individu ou tout groupe d’individus peut devenir le « bouc émissaire » de sa propre communauté. Mettre l’accent sur les droits de l’homme c’est s’efforcer de prévenir et de contrôler les emballements mimétiques incontrôlables.
Le double héritage nietzschéen.
Depuis des siècles, le plus de justice que nous devons aux soucis des victimes libère nos énergies, augmente notre puissance mais nous soumet également à des tentations auxquelles le plus souvent nous succombons, conquêtes coloniales, abus de pouvoir, guerres monstrueuses du XXème siècle, mise au pillage de la planète, etc…
« Dionysos contre le crucifié » : la voici bien l’opposition. Ce n’est pas une différence quant au martyre, mais celui-ci a un sens différent. La vie même, son éternelle fécondité, son éternel retour, détermine le tournant, la destruction, la volonté d’anéantir. Dans l’autre cas, la souffrance, le « crucifié » en tant qu’il est l’ » innocent », sert d’argument contre cette vie, de formule de sa condamnation » Nietzsche fragments posthumes 1888-1889.
Entre Dionysos et Jésus, il n’y a « pas de différence quant au martyre », autrement dit les récits de la Passion racontent le même type de drame que les mythes, c’est le « sens » qui est différent. Tandis que Dionysos approuve et organise le lynchage de la victime unique, Jésus et les Evangiles le désapprouvent. Malgré d’innombrables victimes, l’entreprise hitlérienne a fini par échouer. Loin d’étouffer le souci des victimes, elle a accéléré ses progrès mai l’a complètement démoralisé. L’hitlérisme se venge de son échec en désespérant le souci des victimes, en le rendant caricaturale.
Depuis l’holocauste, en revanche, on n’ose plus s’en prendre au judaïsme, et le christianisme est promu au rôle de bouc émissaire numéro un. L’antéchrist se flatte d’apporter aux hommes la paix et la tolérance ce que le christianisme leur promet mais ne leur apporte pas.
Conclusions.
La vraie démystification n’a rien à voir avec les automobiles et l’électricité, contrairement à ce que BULTMAN imaginait, elle vient de notre tradition religieuse. Nous autres « modernes » croyons posséder la science infuse du seul fait que nous baignons dans « notre modernité ». Cette tautologie que nous nous répétons depuis trois siècles nous dispense de penser.
Pour rompre l’unanimité mimétique, il faut postuler une force supérieure à la contagion violente et, si nous avons appris une seule chose dans cet essai, c’est qu’il n’en existe aucune sur cette terre. La résurrection fait appréhender à Pierre et à Paul, et derrière eux à tous les croyants, que tout enfermement dans la violence sacrée est violence contre le Christ. L’homme n’est jamais la victime de Dieu, Dieu est toujours la victime de l’homme. »
http://lirephilosopher.canalblog.com/archives/2014/06/17/30090619.html
René Girard : Portando Clausewitz all’estremo, cultura
Menzogna romantica e verità romanzesca, René Girard
capro espiatorio : René Girard | controappuntoblog.or
su Freud il “narcisismo delle piccole differenze” + altro
Gadda : Il Primo Libro delle Favole | Flickr – Photo Sharing! by Andrea Speziali
 I rettangolari architetti farebbono cipria del Borromini, come di colui che rettangolare non è, ma cavatappi.
I rettangolari architetti farebbono cipria del Borromini, come di colui che rettangolare non è, ma cavatappi.
Questa favoletta ne certifica: la parola d’ordine rinnova le opere: e l’opere nuove trovano parole a essere commendate.
**********
Un navicellaio aveva a passar lo Stretto, e con il mare alle brutte: Scilla, dalle molte bocche faceva le boccacce, Caribdi, dai dentolini di squalo, in tra il frangente e l’onda ne andava dimostrando l’aguto.
Si pensò, il buon padrone, di rabbonire i due mostri: col lasciar loro intendere non tutti i navicelli sono boccon da Scilla: o Caribdi. Richieduti i congiunti se in quel commosso verde, che aveva quel dì le male creste con più rabbuffi di spuma, gli volesse alcun di loro venir compagno a seco dividere i perigli, e’ l’andava facendo luogo tra le botti, in coperta, da poterlo accomodare per il meglio.
************
Achille e la tartaruga
La cheli, estromesso il capo, annaspava un’idea: commise con il Piè Veloce che lo avrebbe superato nella corsa, quando bastavale alcuna precedenza alle mosse. Disse il Tachipo: “di buona misura, affè di Giove!: prenditi una parasanga in avanti”. “Che sì, che sì”, fece la scudata nonna: e biasciando non si sa che liquerizia codeste befane le le suggano, l’andava rivolgendo guancia scarna di là, poi di qua, non sopravvenissero e’ micidî, come son ghespe o lambruzze: finchè la si risolvette al cammino, da dover consumare quella anticipata parasanga. E poi di molto arrancare delle quattro spatole, con chel crostone del clipeo così rappreso in sulla sua testudinata pertinacia, alfine la vi pervenne.
Dal buon centauro, allora, sendogli in nell’antra mano la clepsidra, si abbassò la bandierola scarlatta: “Addio Chirone!”: “addio ragazzo!” Ed eccolo a perdifiato lasciare dietro di sè le pianure come liberata saetta: che davano scàlpito gli quattro zoccoli, al savio, con gran fersate di sua coda: e ne venía scintille dalle selci quasi da solicitata focaia.
Tre diti in nella superna fiala non avea scemato la polvere, e ‘l Tachipo aveva fatto il vantaggio. Ma la tortuca, in fra tanto, avacciò di chel vantaggio un millesimo.
Achille fece il millesimo. Ma la Tortuca, in fra tanto, avacciò un millesimo di chel millesimo.
Mai dunque potè chiapparla: e ancor oggi e’ fuggano.
(Carlo Emilio Gadda, Il primo libro delle favole, Garzanti, Milano1952, disegni di Mirko Vucetich)
Il Primo Libro delle Favole | Flickr – Photo Sharing!
Il primo libro delle favole – Carlo Emilio Gadda – Google Books
Gnommero, obdurare, globeavano «”Hiva-i-Ità-ia!, Hiva-i-Ità …
“Racconto italiano di ignoto del novecento” di Carlo Emilio …
La cognizione del dolore | controappuntoblog.org
Gadda : L’ortolano di Rapallo | controappuntoblog.org
La scienza del dolore Il linguaggio tecnico-scientifico nel ..
“Racconto italiano di ignoto del novecento” di Carlo Emilio .
Carlo Emilio Gadda: I viaggi e la morte – I Luigi di Francia …
DA GADDA A GERMI | controappuntoblog.org
“i pasticciacci” di un buonannulla di genio | controappuntoblog.org
Genius Loci : Alberto Arbasino
lo sguardo artistico ” amatoriale” di Pasolini
Il senso del suono secondo Pasolini di Michele Fumagallo ..
qualcuno mi ha detto che a Pasolini piaceva il blues, pure
Frammento alla morte Pasolini e tutto PPP su controappunto blog
Todo es santo. | controappuntoblog.org
Sogno-Dal film-Accattone | controappuntoblog.org
Pasolini – vecchiaia | controappuntoblog.org
Pier Paolo Pasolini – Terra di lavoro : canto per me
Profezia : Pier Paolo Pasolini | controappuntoblog.org
Pasolini l’enragé – Le Mura Di Sana’a ; La pietà e l’edonè …
Pier Paolo Pasolini Manifesto per un nuovo teatro : Orgia 1968
il testamento profezia di Pasolini che disturba sempre: se
Ho nostalgia della gente povera e vera che si batteva pe
visto che quasi tutti accattoni …Accattone di PPP .
La nebbiosa : Pier Palo Pasolini | controappuntoblog.org
La fidanzata di Pasolini – Che cosa sono le nuvole
Pier Paolo Pasolini – Terra di lavoro : canto per me .
Il vangelo seconto matteo di Pasolini compie 50 anni – Il …
Pier Paolo Pasolini – Il Vangelo secondo Matteo – strage ..
Vangelo secondo Matteo Pier Paolo Pasolini. LA MADRE …
mamma roma e vivaldi
Crocifissione : PIER PAOLO PASOLINI | controappuntoblog …
Porcile 1968-69 Pier Paolo Pasolini al cinema e teatro ; e …
Poesie a Casarsa ed altro di Pasolini su controappunto blog …
il testamento profezia di Pasolini che disturba sempre: se l …
Laviamoci il cervello: RoGoPaG | controappuntoblog.org
New York celebra Pier Paolo Pasolini al MOMA -A Pasolini …
Petrolio | controappuntoblog.org
Pasolini e don Milani – controappuntoblog.org
la parola alla non cittadina Medea ; Medea di Pasolini …
visto che quasi tutti accattoni …Accattone di PPP …
Trasumanar e organizzar | controappuntoblog.org
Mimesis Figure di realismo e postrealismo dantesco nell’opera di …
Pier Paolo Pasolini : Studi sullo stile di Bach | controappuntoblog.org
Teorema – Pier Paolo Pasolini ( Film completo ) Subtitles ENG SPA …
Affabulazione (Selections) Thomas Simpson – controappuntoblog.org
Supplica a mia madre
Pier Paolo Pasolini – Lettere Luterane (I giovani infelici …
Bestemmia: Pier Paolo Pasolini | controappuntoblog.org
Pasolini Mamma Roma finale | controappuntoblog.org
Pier Paolo Pasolini Manifesto per un nuovo teatro : Orgia 1968
Alla bandiera rossa | controappuntoblog.org
L’alba meridionale : Pier Paolo Pasolini | controappuntoblog …
Uccellacci e uccellini, Primo soggetto 1965 …a prescindere
Uccellacci e uccellini …a prescindere | controappuntoblog.org
a prescindere , “Uccellacci e uccellini” | controappuntoblog.org
Accattone | controappuntoblog.org
Una vita violenta Pier Paolo Pasolini | controappuntoblog.org
La Ricotta Pier Paolo Pasolini | controappuntoblog.org
Stracci e P.P. P. | controappuntoblog.org
il pianto della scavatrice – Bach – Wir setzen uns mit Tränen …
Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà
Marx to Ruge e il sogno di una cosa | controappuntoblog.org
L’articolo delle lucciole | controappuntoblog.org
2 P POETICA | controappuntoblog.org
E basti tu, col tuo profumo, oscuro, caduco rampicante
Non è di maggio questa impura aria – controappuntoblog.org
Il vangelo seconto matteo di Pasolini compie 50 anni – Il …
Pier Paolo Pasolini – Il Vangelo secondo Matteo – strage …
Marylin – Pier Paolo Pasolini | controappuntoblog.org
La rosa è la forma delle beatitudini. Beata l’angoscia in …
cinema etnografico da Faherty,Wright .Bateson -Mead ad …
Teorema – Pier Paolo Pasolini ( Film completo ) Subtitles …
STANLEY KUBRICK – dai romanzi allo schermo, 8 euro : Kubrick gratis qui
Fino al 2 novembre 2015, presso la Sala AcomeA del Teatro Franco Parenti di Milano si svolgerà il ciclo di serate “Stanley Kubrick: dai romanzi allo schermo”.
Una rassegna in cui far emergere la passione per la letteratura di un maestro del cinema, evidenziando il modo in cui questa ha intrecciato la trama di alcuni dei suoi più grandi capolavori cinematografici.
Nel corso di 5 serate saranno proiettati 5 grandi capolavori di Kubrick in lingua originale, sottotitolati, tratti da 5 grandi romanzi, e ogni film sarà introdotto da un attore d’eccezione che leggerà brani dai romanzi da cui sono tratti. Ieri, 5 ottobre, la prima con “Lolita“, anticipata dalle letture di Filippo Dini del romanzo di Vladimir Nabokov.
Kubrick: Il programma
Domenica 11 ottobre, ore 20: Eyes Wide Shut (1999), con letture di Anna Della Rosa da Doppio sogno di Arthur Schnitzler
Lunedì 19 ottobre, ore 20: Barry Lyndon (1975), con letture di Corrado Tedeschi da Le memorie di Barry Lyndon di William M. Thackeray
Lunedì 26 ottobre, ore 20: Clockwork Orange (1971), con letture di Massimo Loreto da Un’arancia a orologeria di Anthony Burgess
Lunedì 2 novembre, ore 20: The Shining (1980), con letture di Rosario Lisma da The Shining di Stephen King
Il costo di ogni biglietto è di 8 euro. Per info: 02 59995206 oppure visitare il sito del teatro.
http://www.booksblog.it/post/133688/stanley-kubrick-dai-romanzi-allo-schermo
Eyes wide shut – Stanley Kubrick : non è un cine panettone .
A VOIX NUE Ecouter Stanley Kubrick (Rare Radio Interview …
Il 2 aprile 1968 esce “2001: Odissea nello Spazio”; io e Kubrick ; The Last Question
Kubrick : 2001 odissea nello spazio – The Last Question
Satanic Temple still plans to unveil devil statue in Detroit ; Eyes wide shut – Stanley Kubrick
Shining Stanley Kubrick : Shining e il Perturbante freudiano – il labirinto , il minotauro
Barry Lyndon : Stanley Kubrick | controappuntoblog.org
Barry Lyndon Original Soundtrack | controappuntoblog.org
Barry Lyndon, scène finale – Franz Schubert .
Fear and Desire – il film rinnegato da Kubrick | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange | controappuntoblog.org
Arancia meccanica | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange – Calculated Captivity | controappuntoblog.org
1 MINUTE OF – Killer’s Kiss (1955) Stanley Kubrick .
[1951] Day of the Fight -”The Killing” rapina a mano armata …
A VOIX NUE Ecouter Stanley Kubrick (Rare Radio Interview …
Paths of Glory “Orizzonti di gloria” Stanley Kubrick .
Barry Lyndon
http://www.controappuntoblog.org/2012/04/12/barry-lyndon/
Barry Lyndon Original Soundtrack | controappuntoblog.org
Fear and Desire – il film rinnegato da Kubrick | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange | controappuntoblog.org
Arancia meccanica | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange – Calculated Captivity | controappuntoblog.org
Spartacus il colossal di Kubrick – LE RIVOLTE SERVILI …
[1951] Day of the Fight -”The Killing” rapina a mano armata : Stan
Full Metal Kubrick – Un dossier provvisorio – no spoilers, just bas
Codigo de Hammurabi -2001Odissea nello Spazio: il monolite …
LE RIVOLTE SERVILI NELL’ANTICA ROMA | controappuntobl
Kubrick : 2001 odissea nello spazio – The Last Question ..
Handel – Sarabande Duel – Barry Lyndon .
Handel – Sarabande | controappuntoblog.org
Handel Sarabande 2015, tag : canto per tutti
Kubrick, Napoleon e il film mai fatto
Kubrick, Napoleon e il film mai fatto che forse si farà per la tv

#Stanley Kubrick’s unrealized project
Anche Kubrick non riuscì a realizzare tutti i film che avrebbe voluto. Lunga è la lista e Napoleon è uno di questi.
Nel 2000 la sceneggiatura fu pubblicata su Internet ma ritirata poco tempo dopo su intervento della Polaris (società che detiene i diritti delle opere di Kubrick).
È probabile che Steven Spielberg produrrà e dirigerà una serie televisiva biografica su Napoleone Bonaparte riprendendo questo progetto.
(da wiki) Napoleon era un colossale progetto cinematografico studiato in ogni minimo dettaglio per oltre trent’anni, preso in considerazione dopo il successo riscosso da 2001: Odissea nello spazio.
Il film avrebbe trattato la vita di Napoleone Bonaparte in modo del tutto epico, portando sul grande schermo ogni singolo momento dell’imperatore, incentrandosi su vari temi tra cui l’aspetto militare e religioso.
Kubrick dichiarò sempre di essere dubbioso circa la realizzazione, ma che se fosse riuscito nell’intento avrebbe creato “il miglior film mai fatto”.
Per interpretare Napoleone Bonaparte, Kubrick pensò inizialmente a Marlon Brando, ma cambiò idea dopo aver visto I due volti della vendetta. Alla ricerca di un protagonista, trovò un giovane e talentuoso Jack Nicholson che partecipava a Easy Rider come uno dei protagonisti, la viva interpretazione catturò l’attenzione di Kubrick, che dopo averlo conosciuto gli propose di vestire i panni di Napoleone in un futuro progetto personale. Nicholson rilasciò una dichiarazione nel 1975 a tal proposito:
| « Ne abbiamo parlato un po’. Ero molto eccitato all’idea, e lo sarei ancora, ma a questo punto ne parliamo da tanto di quel tempo che la cosa si è quasi spostata nel regno dei sogni a occhi aperti. Non penso che succederà mai, sapendo come sono i registi, capricci, fisse e tutto quanto.Sarebbe bello. Ho un piano di riserva se lui non mi dovesse usare. Mi limiterò a fare un film migliore. Lo dico per scherzo, naturalmente. Mi ha interessato al personaggio. Ho fatto ricerche su di lui, e su tutta quella roba, e mi piacerebbe prima o poi usare quel materiale. » |
Dopo l’abbandono del progetto, Nicholson e Kubrick rimasero comunque in contatto, e infatti all’attore venne affidato il ruolo da protagonista in un nuovo film del regista, Shining.
Sceneggiatura
La sceneggiatura preliminare fu stesa da Kubrick, per la cui scrittura durata più di due anni si dedicò – pare – alla lettura di 500 biografie e alla raccolta di oltre 18.000 opere letterarie sull’impero francese e l’era napoleonica, scattando oltre 7.000 fotografie ai luoghi scelti per le riprese.
Con l’aiuto dello storico inglese Felix Markham, professore presso l’università di Oxford, e dei suoi migliori venti allievi si mise alla ricerca delle più importanti biografie su Napoleone, arrivando ad archiviare più di 500 libri in modo meticoloso, ogni informazione possibile, dalle date ai luoghi, alle persone rilevanti o meno nella sua vita.
La fase di sviluppo di Napoleon richiese molti anni di studi e ricerche accurate sul soggetto.
Poi il progetto fu abbandonato. Perduta per anni fu ritrovata casualmente nel 1994 da Jeff Kleeman, un impiegato della United Artists, in una miniera di sale presso Hutchison (Kansas), nata dalle macerie di un edificio inutilizzato adibito – prima dell’abbandono – all’archiviazione di sceneggiature e dati di produzione di film MGM.
http://www.chiaramicheli.it/kubrick-napoleon-e-il-film-mai-fatto-che-forse-si-fara-per-la-tv/
STANLEY KUBRICK – dai romanzi allo schermo, 8 euro : Kubrick gratis qui
Eyes wide shut – Stanley Kubrick : non è un cine panettone .
A VOIX NUE Ecouter Stanley Kubrick (Rare Radio Interview …
Il 2 aprile 1968 esce “2001: Odissea nello Spazio”; io e Kubrick ; The Last Question
Kubrick : 2001 odissea nello spazio – The Last Question
Satanic Temple still plans to unveil devil statue in Detroit ; Eyes wide shut – Stanley Kubrick
Shining Stanley Kubrick : Shining e il Perturbante freudiano – il labirinto , il minotauro
Barry Lyndon : Stanley Kubrick | controappuntoblog.org
Barry Lyndon Original Soundtrack | controappuntoblog.org
Barry Lyndon, scène finale – Franz Schubert .
Fear and Desire – il film rinnegato da Kubrick | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange | controappuntoblog.org
Arancia meccanica | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange – Calculated Captivity | controappuntoblog.org
1 MINUTE OF – Killer’s Kiss (1955) Stanley Kubrick .
[1951] Day of the Fight -”The Killing” rapina a mano armata …
A VOIX NUE Ecouter Stanley Kubrick (Rare Radio Interview …
Paths of Glory “Orizzonti di gloria” Stanley Kubrick .
Barry Lyndon
http://www.controappuntoblog.org/2012/04/12/barry-lyndon/
Barry Lyndon Original Soundtrack | controappuntoblog.org
Fear and Desire – il film rinnegato da Kubrick | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange | controappuntoblog.org
Arancia meccanica | controappuntoblog.org
A Clockwork Orange – Calculated Captivity | controappuntoblog.org
Spartacus il colossal di Kubrick – LE RIVOLTE SERVILI …
[1951] Day of the Fight -”The Killing” rapina a mano armata : Stan
Full Metal Kubrick – Un dossier provvisorio – no spoilers, just bas
Codigo de Hammurabi -2001Odissea nello Spazio: il monolite …
LE RIVOLTE SERVILI NELL’ANTICA ROMA | controappuntobl
Kubrick : 2001 odissea nello spazio – The Last Question ..
Handel – Sarabande Duel – Barry Lyndon .
Handel – Sarabande | controappuntoblog.org
Handel Sarabande 2015, tag : canto per tutti
Hear Gerald Horne speak about his new book, Confronting Black Jacobins ; Queimada Completa ; link….
Hear Gerald Horne speak about his new book, Confronting Black Jacobins, at Tamiment Library, New York University, October 30
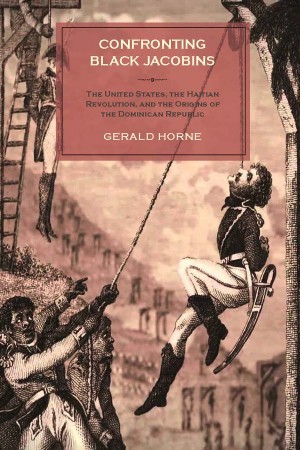
Professor of History and African American Studies at the University of Houston, Gerald Horne, recorded by Mitchel Cohen for WBAI-FM radio at New York University’s Tamiment Library, talks about why a study of the 1804 Haitian Revolution might be relevant to today:
“It’s mandatory to tease out the contemporary repercussions of historical events, and I say this particularly standing here in New York in the United States of America, where there is an ongoing crisis. We need deeper thinking, not least on of this spate of televised, almost pornographic, murders . . . Of course, I’m speaking of Eric Garner, who was killed right here in this city, but of course also Freddie Gray and Sandra Bland . . .”
http://monthlyreview.org/press/hear-gerald-horne-speak-about-his-new-book-confronting-black-jacobins-at-tamiment-library-new-york-university-october-30/
Queimada (Completa con subtítulos) , Burn! : “Nessuno, con …
Haiti: 12 gennaio 2010 + (1791-1803). Salutoni rossi .
Ennio Morricone – Queimada | controappuntoblog.org
Queimada “valigia signor” | controappuntoblog.org
Queimada di G.Pontecorvo – discorso su schiavo od .
KKK massacre North CarolinaGreensboro 3/11/ 1979 ;KKK post di questi anni
Terrorism in Charleston discussion: collage ..
We Shall Overcome: Charleston Mourns Together At Vigil
Strage di neri a Charleston : non è una questione di vendita armi, è razzismo ; the racial question ,collage ….
Ku Klux Klan 1º Parte | controappuntoblog.org
Ku Klux Klan | controappuntoblog.org
A large crowd of protesters gathered at the Craig Ranch ; USA: the racial question ,collage ….
USA: Police officer manhandles, pulls gun on black teenagers – USA: the racial question
USA: the racial question ,collage | controappuntoblog.org
No charges for US police officer in shooting death of black teen
As investigation enters fifth month, Tamir Rice’s mother has moved into a homeless shelter
Baltimora : FOP calls on prosecutor torecuse herself, defends officers Baltimore Sun, scarcerati su cauzione
Those stories that Freddie Gray had a pre-existing spinal injury are totally bogus
BaltimoreRiots #FreddieGray – Emeute à Baltimore après la mort d’un jeune – 25 avril 2015
Baltimora: by any means necessary by clashcityworkers
On the Run: Fugitive Life in an American City : turns pages
Emeutes à Baltimore après la mort d’un jeune – 27 avril 2015 – avec vidéos: Freddie Gray Funeral
Baltimore mayor calls for ‘peaceful and respectful’ protests
Justice is not an abstract concept. Justice is a living #FreddieGray. Justice is a smiling #RekiaBoyd. Justice is no more death.
Freddie Gray Another black man Death : Baltimore protests
USA: Funeral service held for African-American police shooting victim Walter Scott
South Carolina police have shot 209 people in the last five years, report finds – new Video
Murder charge for S. Carolina cop who shot black man 8 times in back ; USA: the racial question
a ‘damn punk” in Ferguson… articolo e video
Usa, ragazzo nero di 18 anni ucciso da poliziotto; USA: the …
2 police officers shot as Ferguson protests turn violent
the day after “selma day” : Another Unarmed Black Man, Killed By Police In Colorado
Bloody Sunday 1965 with John Lewis Interview – Malcolm X in Selma
Bloody Sunday Selma : Black Teen Tony Robinson Protesters
Malcolm X : Omaha, 19 maggio 1925 – New York, 21 febbraio 1965 ; “I Can’t Breathe” in USA
8 aprile 1964: Malcolm X interviene al Militant Labour Forum …
The case of Trayvon Martin: Fight Racism! Fight Capitalism ..
Rosa Parks Arrested December 1, 1955 – The case of …
Charges Dismissed Against Joseph Weekley, Cop Who Fatally Shot Sleeping 7-Year-Old
Eric Garner : affrontements à Seattle contre la relaxe du
“I Can’t Breathe” – Racism is also a reproductive rights issue
No more Missouri compromises – John Garvey by libcom – Phillis Wheatley
Protests erupt in New York after jury decision in police death
No more Missouri compromises – John Garvey by libcom …
Ferguson brucia, l’agente che sparò e uccise il 18enne nero non sarà incriminato :25 novembre 2014
Stati Uniti ucciso altro giovane nero , e video significativo per i commenti sopratutto…
Bloody Sunday Selma : Black Teen Tony Robinson Protesters
Rosa Parks Arrested December 1, 1955 – The case of …
marcia a Washington contro le violenze della polizia nei
St. Louis: ultimo ucciso afroamericano ; riassunto ultimi uccisi
Note: this contains both graphic language and violence …
Ferguson. Oggi i funerali di Mike Brown …
Michael Brown colpito almeno sei volte. Nuovi scontri
Michael Brown l’ultimo giovane nero ucciso dalla polizia: analisi e video ; Trayvon Martin – Ramona Africa Speaks
Mississippi Burning – Le radici dell’odio | controappuntoblog …
Alain Delon ha 80 anni !
Rocco e i suoi fratelli : il cinema e la Storia
http://www.controappuntoblog.org/2013/04/08/34726/
my favourite scene di Rocco e i Suoi Fratelli
Rocco e i suoi fratelli (1960) film completo
Il buio finale | controappuntoblog.org
S.Freud : Zeitgemäßes über Krieg und Tod – la guerre et sur la mort par Bernard UMBRECHT
Zeitgemäßes über Krieg und Tod – Internet Archive
S.Freud : Actuelles sur la guerre et sur la mort (1915)
Au déclenchement de la Première guerre mondiale, Sigmund Freud avait offert sa libido à l’Autriche-Hongrie. Fin août 1914 déjà, sa « libido tourne à la rage ». Dans un texte de 1915, il parle de la désillusion et de la modification du rapport à la mort produites par les premiers mois du conflit.
A supposer que l’on veuille tenter comme nous le faisons ici de comprendre quelque chose à la Première guerre mondiale, l’erreur à ne pas commettre serait de se fier exclusivement aux historiens. La plupart d’entre eux ont une curieuse propension à faire fi de l’histoire de la pensée tout comme de l’histoire des arts et de la littérature.
Il y a des choses à penser sur cette guerre. Cela a été fait. Pourquoi l’ignorer ?
C’est pour cela que je continue dans le cadre de ces lectures de la Première guerre mondiale à poser quelques jalons d’une réflexion. Il y a eu Le vacarme de la bataille et le silence des archives par Helmut Lethen, La guerre continuée d’Antonin Artaud, La société de guerre vue par Wolfgang Sofsky, Marc Crépon (avec Romain Rolland) : 14-18 et le consentement meurtrier
Aujourd’hui Sigmund Freud.
Les Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort écrites par Freud datent de 1915, plus précisément de mars et avril 1915. La guerre durait depuis 8 mois. La désillusion qui fera l’objet de sa réflexion a été rapide. Elle est celle de Freud lui-même et de ses contemporains. Au déclenchement de la guerre, Freud avait, dit-il, offert sa libido à l’Autriche-Hongrie. Et deux de ses fils. Le troisième sera incorporé après la rédaction de l’essai dont il sera question plus loin.
Fin août 1914 déjà, sa « libido tourne à la rage ». Il écrit au psychanalyste hongrois Sandor Ferenczi :
« Le processus intérieur a été le suivant : la montée d’enthousiasme, en Autriche, m’a d’abord emporté moi aussi. […] J’espérais qu’une patrie viable me serait donnée, d’où la tempête de la guerre aurait balayé les pires miasmes, et où les enfants pourraient vivre en confiance. J’ai mobilisé tout d’un coup […] de la libido pour l’Autriche-Hongrie […] Peu à peu un malaise s’est installé [avec] la sévérité de la censure et le gonflement des plus petits succès[…]. Je vois ma libido tourner en rage, dont on ne peut rien faire »
Cité par Peter Loewenberg : L‘agressivité pendant la Pemière guerre mondiale : l’auto-analyse approfondie de Sigmund Freud Revue germanique internationale
Le titre de l’essai, en allemand Zeitgemässes über Krieg und Tod, choses de saison sur la guerre et la mort souligne que Freud intervient pour ainsi dire à chaud sur un événement qui n’est pas achevé, qui dure encore. Comme une chronique d’actualité. Il y en avait assez pour faire le constat de la désillusion et de la mort de masse. L’essai se décompose en ces deux parties :1) La désillusion causée par la guerre ; 2) notre relation à la mort
Le titre de l’essai, en allemand Zeitgemässes über Krieg und Tod, choses de saison sur la guerre et la mort souligne que Freud intervient pour ainsi dire à chaud sur un événement qui n’est pas achevé, qui dure encore. Comme une chronique d’actualité. Il y en avait assez pour réfléchir à la désillusion et à la mort de masse. L’essai se décompose en ces deux parties :1) La désillusion causée par la guerre ; 2) notre relation à la mort
La désillusion causée par la guerre commence par le constat affligeant et troublant des destructions « de biens précieux communs à l’humanité », on peut pense par exemple à la cathédrale de Reims, et de l’égarement de l’intelligence :
« Pris dans le tourbillon de ces années de guerre, informé unilatéralement, sans recul par rapport aux grands changements qui se sont déjà accomplis ou sont en voie de s’accomplir, sans avoir vent de l’avenir qui prend forme, nous-mêmes ne savons plus quel sens donner aux impressions qui nous assaillent et quelle valeur accorder aux jugements que nous formons. Nous serions tenté de croire que jamais encore un événement n’avait détruit tant de biens précieux communs à l’humanité, égaré tant d’intelligences parmi les plus lucides, si radicalement abaissé ce qui était élevé. Même la science a perdu son impassible impartialité; ses serviteurs profondément ulcérés tentent de lui ravir des armes, pour apporter leur contribution au combat contre l’ennemi. L’anthropologiste se doit de déclarer l’adversaire inférieur et dégénéré, le psychiatre de diagnostiquer chez lui un trouble mental ou psychique. Mais, sans doute, ressentons-nous le mal de ce temps avec une force excessive et n’avons-nous pas le droit de le comparer au mal d’autres temps que nous n’avons pas vécus. »
Dans un texte intitulé Ruines qui lui est attribué et qui est paru en septembre 1914 dans la Correspondance social-démocrate n°112, Rosa Luxemburg souligne avec beaucoup de force l’énorme paradoxe du capitalisme tout à la fois capable de créer des œuvres les plus sublimes pour les détruire ensuite à une vitesse vertigineuse. Et recommencer.
“ Le capitalisme moderne, écrit-elle, fait triompher son chant satanique dans l’actuel ouragan mondial. Il n’y a que lui pour accumuler en quelques décennies autant de richesses scintillantes et les œuvres culturelles les plus brillantes pour les transformer en quelques mois en champs de ruines avec les moyens les plus raffinés. Il n’y a que le capitalisme pour réussir à faire de l’homme le prince des terres, des mers et des airs, un demi-dieu joyeux, maître des éléments pour ensuite le laisser crever dans la misère, dans les débris de sa propre splendeur dans des souffrances qu’il a lui-même produites”.
Freud ne parle pas de la guerre du soldat au front dont il dit qu’il est « une infime particule de la gigantesque machine de guerre ». Son propos concerne la « misère psychique de ceux de l’arrière ».
Il pose d’abord un droit à condamner les guerres et aspirer à la paix :
« Quand je parle de désillusion, chacun sait aussitôt ce que j’entends par là. Sans avoir besoin d’être un fanatique de la pitié, tout en reconnaissant la nécessité biologique et psychologique de la souffrance pour l’économie de la vie humaine, on n’en a pas moins le droit de condamner la guerre dans ses moyens et ses buts et d’aspirer à la cessation des guerres. »
Comme le note Marc Crépon1, « il n’y a de désillusion que sur le fond d’une illusion qui la précède » Faut-il en parler au singulier ? Je préférerais décomposer cette illusion en différents éléments. Ce n’est pas « La grande illusion » de Renoir. On se souvient qu’à la fin du film les évadés Maréchal (Jean Gabin) et Rosenthal (Marcel Dalio) se séparent sur ces mots : « faut bien qu’on la finisse cette putain de guerre en espérant que c’est la dernière », dit Maréchal. La voilà « la grande illusion » réplique Rosenthal. Les illusions dont parle Freud portent sur les mécanismes de déclenchement des guerres entre nations civilisées, le basculement de la libido des hommes civilisés de l’enthousiasme à la rage. On pensait, dit le fondateur de la psychanalyse, que les guerres provenaient d’écarts entre les conditions d’existence, d’états de sous-développement et de divergences d’appréciation sur la valeur de la vie. Des grandes nations civilisées, on n’attendait pas la guerre mais autre chose :
« Des grandes nations de race blanche régnant sur le monde, auxquelles incombe la direction du genre humain, que l’on savait employées à défendre certains intérêts communs au monde entier, et dont l’œuvre comprend aussi bien les progrès techniques dans la domination de la nature que les valeurs artistiques et scientifiques de civilisation – de ces peuples-là, on avait attendu qu’ils fussent capables de résoudre par d’autres voies les dissensions et les conflits d’intérêts »
Non seulement cela mais – deuxième illusion – on pouvait s’attendre à ce que les États qui « avaient établi pour l’individu des normes morales élevées » « les respecterait lui-même et qu’il n’avait pas l’intention de rien entreprendre contre elles, ce par quoi il eût nié les fondements de sa propre existence »
Enfin, – troisième illusion – « on pouvait penser que les grands peuples, quant à eux, auraient acquis une conscience suffisante de leur communauté et assez de tolérance à l’égard de leur disparité, pour qu’il ne fût plus possible de fondre en une seule acception, comme c’était encore le cas dans l’antiquité classique, « étranger » et « hostile » ».
L’illusion est tellement forte que « confiants en cette union des peuples civilisés, un nombre incalculable d’hommes ont changé leur résidence dans la patrie contre un lieu de séjour à l’étranger et lié leur existence aux relations entretenues entre eux par les peuples amis ».
On se croyait dans une communauté de peuples civilisés. L’illusion était de ne pas croire que la guerre pouvait éclater entre peuples d’un degré à peu près équivalent de culture. Et cette guerre n’en est que plus terrible.
« Et voilà que la guerre, à laquelle nous ne voulions pas croire, éclata et apporta la … désillusion. Elle n’est pas seulement, en raison du puissant perfectionnement des armes offensives et défensives, plus sanglante et plus meurtrière qu’aucune des guerres antérieures, mais elle est pour le moins aussi cruelle, acharnée, impitoyable, que toutes celles qui l’ont précédée. Elle rejette toutes les limitations auxquelles on se soumet en temps de paix et qu’on avait appelées droit des gens, elle ne reconnaît pas les prérogatives du blessé et du médecin, ne fait pas de distinction entre la partie non belligérante et la partie combattante de la population et nie les droits de la propriété privée. En proie à une rage aveugle,’ elle renverse tout ce qui lui barre la route, comme si après elle il ne devait y avoir pour les hommes ni avenir ni paix. Elle rompt tous les liens faisant des peuples qui se combattent actuellement une communauté et menace de laisser derrière elle une animosité qui pendant longtemps ne permettra pas de les renouer. »
S’ajoute à cela que l’État qui fait la guerre se permet tout, à l’extérieur comme à l’intérieur, en nous sommant d’y adhérer au nom du patriotisme
« L’État qui fait la guerre se permet toutes les injustices, toutes les violences, ce qui déshonorerait l’individu. Il se sert contre l’ennemi non seulement de la ruse autorisée, mais aussi du mensonge conscient et de la tromperie délibérée, et le fait, certes, dans des proportions qui semblent dépasser tous les usages des guerres antérieures. L’État exige de ses citoyens le maximum d’obéissance et de sacrifices, tout en faisant d’eux des sujets mineurs par un secret excessif et une censure des communications et expressions d’opinions, qui met ceux qu’on a ainsi intellectuellement opprimés hors d’état de faire face à toute situation défavorable et à toute rumeur alarmante. Il s’affranchit des garanties et des traités par lesquels il s’était lié envers d’autres États, il ne craint pas de confesser sa rapacité et sa soif de puissance, que l’individu doit alors approuver par patriotisme ».
Tout cela explique que le citoyen du monde civilisé « peut se trouver désemparé dans un monde qui lui est devenu étranger – sa grande patrie en ruine, les biens communs dévastés, les concitoyens divisés et avilis! » :
« Le remaniement des pulsions « mauvaises » est l’œuvre de deux facteurs agissant dans le même sens, l’un interne et l’autre externe. L’influence exercée sur les pulsions mauvaises – disons égoïstes – par l’érotisme, besoin d’amour de l’homme pris dans son sens le plus large, constitue le facteur interne. Du fait de l’adjonction des composantes érotiques, les pulsions égoïstes se changent en pulsions sociales. On apprend à voir dans le fait d’être aimé un avantage qui permet de renoncer à tous les autres. Le facteur externe est la contrainte imposée par l’éducation qui représente les exigences de la civilisation ambiante et qui est relayée par l’intervention directe d’un milieu civilisé. La civilisation a été acquise par le renoncement à la satisfaction pulsionnelle et elle réclame de chaque nouveau venu qu’il accomplisse le même renoncement pulsionnel. Au cours de la vie d’un individu s’opère une constante transposition de la contrainte externe en contrainte interne. Des influences de la civilisation il résulte qu’une part toujours plus grande des tendances égoïstes se transforme, grâce aux apports érotiques, en tendances altruistes et sociales. On peut finalement admettre que toute contrainte interne, qui se fait sentir dans le développement de l’homme, n’était à l’origine, c’est-à-dire au cours de l’histoire de l’humanité, qu’une contrainte externe. Les hommes qui naissent aujourd’hui apportent avec eux – organisation héritée – une partie de la tendance (disposition) à transformer les pulsions égoïstes en pulsions sociales, tendance qui mène à bien cette transformation, en réponse à de légères incitations. Une autre partie de cette transformation pulsionnelle doit nécessairement s’accomplir au cours de la vie elle-même. C’est ainsi que l’individu, non seulement se trouve soumis à l’action de son milieu civilisé actuel, mais subit également l’influence de l’histoire de la civilisation ancestrale.
En donnant à la capacité impartie à un homme de remanier ces pulsions égoïstes sous l’influence de l’érotisme le nom d’aptitude à la civilisation, nous pouvons dire que celle-ci se compose de deux parties – l’une étant innée et l’autre acquise au cours de la vie – et que le rapport que les deux ont entre elles et avec la partie restée inchangée de la vie pulsionnelle est très variable ».
Le problème est que l’aptitude à la civilisation a été surestimée. Il régnait l’illusion que les peuples étaient plus civilisés qu’on ne le croyait. Le verdict de Freud est terrible :
« notre affliction et notre douloureuse désillusion provoquées par le comportement non civilisé de nos concitoyens du monde durant cette guerre étaient injustifiées. Elles reposaient sur une illusion à laquelle nous nous étions laissé prendre. En réalité ils ne sont pas tombés aussi bas que nous le redoutions, parce qu’ils ne s’étaient absolument pas élevés aussi haut que nous l’avions pensé d’eux ».
Freud conclut cette partie ainsi :
« Pourquoi, à vrai dire, les individus-peuples se méprisent-ils, se haïssent-ils, s’abhorrent-ils les uns les autres, même en temps de paix, et pourquoi chaque nation traite-t-elle ainsi les autres?, cela certes est une énigme. Je ne sais pas répondre à cette question. Dans ce cas, tout se passe comme si, dès lors qu’on réunit une multitude, voire même des millions d’hommes, toutes les acquisitions morales des individus s’effaçaient et qu’il ne restât plus que les attitudes psychiques les plus primitives, les plus anciennes et les plus grossières. Seuls des développements ultérieurs pourront peut-être apporter quelques modifications à ce regrettable état de choses. Mais un peu plus de sincérité et de franchise de tous côtés dans les relations des hommes entre eux et dans les rapports entre les hommes et ceux qui les gouvernent, pourrait également aplanir les chemins de cette transformation ».
Il y a comme des résonances d’actualité dans ce passage.
La relation à la mort
Le second facteur de trouble, lié à la désillusion, concerne la relation à la mort que nous avons pour nous-même tendance à mettre de côté, en faisant comme si elle ne faisait pas partie de la vie. La guerre – la mort de masse – balaie la manière conventionnelle de traiter la mort. Nous avions l’habitude de nier la mort. Mais :
« La mort ne se laisse plus dénier; on est forcé de croire en elle. Les hommes meurent réellement et non plus isolément mais en nombre, souvent par dizaines de mille en un seul jour. Et il ne s’agit plus de hasard. Il apparaît certes encore que c’est par hasard que cette balle atteint l’un et pas l’autre, mais cet autre, une seconde balle peut aisément l’atteindre; l’accumulation met fin à l’impression de hasard. »
Pour comprendre cette perturbation Freud fait appel à « l’homme des premiers âges » qui a eu à l’égard de la mort une attitude contradictoire :
« D’une part, il a pris la mort au sérieux, l’a reconnue comme abolition de la vie et s’est servi d’elle en ce sens, mais d’autre part il a également nié la mort, l’a réduite à rien. Cette contradiction a été rendue possible par le fait qu’il avait sur la mort de l’autre, de l’étranger, de l’ennemi, une position radicalement différente de celle qu’il avait sur sa propre mort. Il s’accommodait fort bien de la mort de l’autre, elle signifiait pour lui l’anéantissement de ce qu’il haïssait et l’homme des origines n’avait aucun scrupule à la provoquer. »
L’histoire est pleine de meurtres et ce depuis les origines.La faute originelle, présente dans maintes religions, est « vraisemblablement l‘expression d‘un crime de sang, dont s’est chargée l’humanité originaire ». Si l’homme des origines ne pouvait pas plus que les contemporains de Freud se représenter et tenir pour réelle sa propre mort, la mort d’un proche changeait la donne. Freud note d’ailleurs que « l’amour ne peut guère être moins ancien que le plaisir de tuer ». Contrairement au soldat de la Première guerre mondiale, l’homme des origines n’est pas un meurtrier impénitent, il doit expier ses meurtres.
« Auprès du cadavre de la personne aimée prirent naissance non seulement la doctrine de l’âme, la croyance en l’immortalité, et l’une des puissantes racines de la conscience de culpabilité chez l’homme, mais aussi les premiers commandements moraux. Le premier et le plus significatif des interdits venus de la conscience morale naissante fut: Tu ne tueras point. Il s’était imposé comme réaction contre la satisfaction de la haine en présence du mort bien-aimé, satisfaction cachée derrière le deuil, et il s’étendit progressivement à l’étranger non aimé et finalement aussi à l’ennemi.
En dernier lieu, cet interdit n’est plus ressenti par l’homme civilisé. Lorsqu’une décision aura mis fin au sauvage affrontement de cette guerre, chacun des combattants victorieux retournera joyeux dans son foyer, retrouvera sa femme et ses enfants, sans être occupé ni troublé par la pensée des ennemis qu’il aura tués dans le corps à corps ou par une arme à longue portée. Il est remarquable que les peuples primitifs, qui vivent encore sur terre et sont certainement plus proches que nous de l’homme des origines, ont sur ce point un comportement différent, ou l’ont eu tant qu’ils n’avaient pas subi l‘influence de notre civilisation. Le sauvage – Australien, Boschiman, Fuégien – n’est nullement un meurtrier impénitent; lorsqu’il revient vainqueur du sentier de la guerre, il n’a pas le droit de pénétrer dans son village ni de toucher sa femme avant d’avoir expié ses meurtres guerriers par des pénitences souvent longues et pénibles. On est actuellement amené à expliquer cela par sa superstition; le sauvage craint encore la vengeance des esprits de ses victimes. Mais les esprits des ennemis abattus ne sont rien d‘autre que l‘expression de sa mauvaise conscience relative à son crime de sang; derrière cette superstition se cache une part de délicatesse morale qui s’est perdue chez nous hommes civilisés ».
Les hommes ont perdu cette éthique originaire née de la mort des proches. Mais cet homme des origines est resté en nous. La guerre le fait réapparaître avec la différence qui vient d’être évoquée, la perte de croyance dans les fantômes des morts
« Elle [la guerre] nous dépouille des couches récentes déposées par la civilisation et fait réapparaître en nous l’homme des origines. Elle nous contraint de nouveau à être des héros qui ne peuvent croire à leur propre mort; elle nous désigne les étrangers comme des ennemis dont on doit provoquer ou souhaiter la mort; elle nous conseille de ne pas nous arrêter à la mort des personnes aimées. La guerre, elle, ne se laisse pas éliminer; aussi longtemps que les peuples auront des conditions d‘existence si différentes et que leur répulsion mutuelle sera si violente, il y aura nécessairement des guerres. Dès lors la question se pose: ne devons–nous pas être ceux qui cèdent et s‘adaptent à la guerre? Ne devons-nous pas convenir qu’avec notre attitude de civilisé à l‘égard de la mort nous avons, une fois encore, vécu psychologiquement au-dessus de nos moyens et ne devons–nous pas faire demi-tour et confesser la vérité? Ne vaudrait–il pas mieux faire à la mort, dans la réalité et dans nos pensées, la place qui lui revient et laisser un peu plus se manifester notre attitude inconsciente à l’égard de la mort, que nous avons jusqu’à présent si soigneusement réprimée. Cela ne semble pas être un progrès, plutôt sous maints rapports un recul, une régression, mais cela présente l’avantage de mieux tenir compte de la vraisemblance et de nous rendre la vie de nouveau plus supportable. Supporter la vie reste bien le premier devoir de tous les vivants. L’illusion perd toute valeur quand elle nous en empêche.
Rappelons-nous le vieil adage: Si vis pacem, para bellum. Si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre. Il serait d‘actualité de le modifier: Si vis vitam, para mortem. Si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort ».
Organise-toi pour la mort. Qu’est-ce à dire ? Je crois que les choses sont plus claires si l’on fait appel à une autre traduction, celle du Dr. S. Jankélévitch que l’on trouve en ligne (voir plus bas) :
« Il serait temps de modifier cet adage et de dire : si vis vitam, para mortem. Si tu veux pouvoir supporter la vie, soit prêt à accepter la mort ».
Quel rapport entre apprendre à supporter la vie en ne refoulant plus la mort et la paix ? Avant de chercher une réponse à cette question, je souhaiterais lever une ambiguïté de ce dernier passage et répondre à ceux qui utilisent un langage pseudo freudien pour justifier qu’il y aura toujours des guerres. Je vais utiliser pour cela un autre texte de Freud. On a vu qu’il pose comme légitime de refuser la guerre. C’est même à partir de là qu’il construit son raisonnement. Il précise ce point dans une lettre à Einstein qui lui demandait : « Pourquoi la guerre ? »
« Pourquoi nous élevons-nous avec tant de force contre la guerre, vous et moi et tant d’autres avec nous, pourquoi n’en prenons-nous pas notre parti comme de l’une des innombrables vicissitudes de la vie ? Elle semble pourtant conforme à la nature, biologiquement très fondée, et, pratiquement, presque inévitable. Ne vous scandalisez pas de la question que je pose ici. Pour les besoins d’une enquête, il est peut-être permis de prendre le masque d’une impassibilité qu’on ne possède guère dans la réalité. Et voici quelle sera la réponse : parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l’individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain contre sa propre volonté, anéantit de précieuses valeurs matérielles, produits de l’activité humaine, etc. On ajoutera en outre que la guerre, sous sa forme actuelle, ne donne plus aucune occasion de manifester l’antique idéal d’héroïsme et que la guerre de demain, par suite du perfectionnement des engins de destruction, équivaudrait à l’extermination de l’un des adversaires, ou peut-être même des deux ».
“Pourquoi la guerre ?” (1933). Correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud. Il s’agit de la version éditée à l’initiative de l’Institut International de Coopération Intellectuelle – Société des nations, en 1933. On la trouve ici
C’est écrit en 1933
Marc Crépon place les Considération actuelles sur la guerre et sur la mort en point de départ de sa réflexion dans Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres. Il écrit :
« De la guerre, Freud, précise, de façon prémonitoire, que si elle perdure dans le monde, c’est parce que celui-ci se donne comme partagé en une pluralité de peuples étrangers les uns aux autres. Tout au long de ses Actuelles sur la guerre et sur la mort, la figure de l’étranger, celle de l’ennemi et la question du rapport à la mort sont de fait indissociables. La perception et la compréhension que nous avons de l’état divisé du monde et notre attitude face à la mort (celle de l’autre – comme étranger et/ou comme ennemi) ne se laissent pas penser séparément. Comment comprendre ce qui les lie ? Cela signifie-t-il que dans un temps qui semble voué au mal, ce sont communément et conjointement le partage du sens du monde et le partage du sens de la mort qui font défaut ? Mais alors en quoi devrait consister ce sens commun? Et comment pourrait-il se laisser partager? »
Marc Crépon : Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres HERRMANN EDITEURS page 16
Cette réflexion, il la prolonge dans un autre livre : Le consentement meurtrier. Il s’en explique ainsi :
Dans Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres, j’arrivais à la conclusion qu’il faudrait penser conjointement l’appartenance au monde comme monde commun et le partage de la mortalité. Mortalité et vulnérabilité sont ce que nous avons le plus en commun, qui dépasse toutes les distinctions de culture, de religion, de langues, etc., bien que cette vulnérabilité soit très inégalement répartie dans le monde. Et c’est parce qu’il n’y a rien que nous ayons davantage en partage avec tout homme, toute femme quelques soient les différences de cultures que ce sentiment de la vulnérabilité et de la mortalité que j’en suis venu à poser le principe éthique de la responsabilité du soin de l’attention et du secours qu’elles exigent de partout et pour tous.
Entretien avec Marc Crépon Autour du Consentement meurtrier – actu philosophia
Nous sommes là dans une cosmopolitique.
Le texte de Freud existe en ligne dans une traduction du Dr. S. Jankélévitch en 1920, revue par l’auteur publié dans l’ouvrage Essais de Psychanalyse Payot. Collection : Petite bibliothèque Payot
J’ai opté ici pour la nouvelle traduction chez le même éditeur où déception devient désillusion.Traducteurs : Pierre Cotet, André Bourguignon et Alice Cherki.
http://www.lesauterhin.eu/freud-actuelles-guerre-mort-1915/
Il perturbante (Das Unheimliche) Freud pdf – Maddalena …
su Freud il “narcisismo delle piccole differenze” + altro .
Censored Voices (Other Israel Film Festival)
il governo israeliano censurò il 70 per cento del materiale. Shapira ha pubblicato il restante 30 per cento nel suo libro “Il settimo giorno:. Parlare dei soldati nella guerra dei sei giorni”
Ora, grazie agli sforzi del regista Mor Loushy, che ha convinto Shapira di darle l’accesso ai nastri, tutte le storie dei soldati possono essere ascoltato. I Films in Israele possono essere oggetto di censura, ma secondo il produttore Hilla Medalia, “Siamo stati in grado di rilasciare il film come lo volevamo.”
‘Censored Voices’ Film Tears Apart Israel’s Heroic Narrative of Six-Day War
 In the wake of the 1967 war, Israel’s victorious soldiers were lionized as heroes; but many didn’t feel that way, a new documentary shows.
In the wake of the 1967 war, Israel’s victorious soldiers were lionized as heroes; but many didn’t feel that way, a new documentary shows.
Anthony Weiss Feb 02, 2015 4:38 AM
(JTA) — In the wake of Israel’s seemingly miraculous triumph in the Six-Day War in 1967, the country’s victorious soldiers were lionized as heroes.
But in private, even just one week after the conflict, many of them didn’t feel that way. One describes feeling sick to his stomach in battle and collapsing into a trench.
“I wanted to be left alone,” he says. “I didn’t think of the war.”
Another talks about watching an old Arab man evacuated from his house.
“I had an abysmal feeling that I was evil,” the soldier says.
The voices come from tapes made just weeks after the war’s conclusion and now presented, some of them for the first time, in the powerful new documentary “Censored Voices,” which premiered Jan. 24 at the Sundance Film Festival here.
Piece by piece and story by story, they tear apart the heroic narrative of Israel’s great victory in favor of something far messier, more chaotic and more human.
The tapes were made by fellow kibbutzniks Avraham Shapira and the novelist Amos Oz, who were driven by a sense that amid the triumphalism, more ambivalent emotions were not being expressed.
“It was a sadness that could only be felt in the kibbutz because we were living so close to each other,” Shapira recalls in the film.
Traveling from kibbutz to kibbutz with a borrowed reel-to-reel tape recorder, Shapira and Oz convinced fellow veterans to open up about their feelings, their memories and their misgivings from the war. But when they moved to publish what they had gathered, the Israeli government censored 70 percent of the material. Shapira published the remaining 30 percent in his book “The Seventh Day: Soldiers’ Talk about the Six-Day War.”
Now, thanks to the efforts of director Mor Loushy, who convinced Shapira to give her access to the tapes, all of the soldiers’ stories can be heard. Films in Israel can be subject to censorship, but according to producer Hilla Medalia, “We were able to release the film as we wanted it.”
The voices from the tapes are combined to great effect with archival footage, photographs, contemporary news accounts and film of the now-aged veterans to tell the story of the war and its aftermath.
What emerges is a vivid portrait of the war as it was lived by those who fought in it. In the tradition of soldier’s-eye narratives like “A Farewell to Arms” and “The Red Badge of Courage,” the movie allows the soldiers to depict themselves as confused, selfishly afraid, often stupefied by the sight of death and dying, and morally troubled when they encounter the enemy as fellow humans.
Amos Oz (JTA)
Conflicting emotions
There is little doubt that prior to the war, the soldiers saw the build-up of hostile Arab forces on their borders as an existential threat.
“There was a feeling it would be a Holocaust,” one says.
Yet once the battle was joined, the soldiers find themselves besieged by a welter of conflicting emotions. They watch their comrades die. They feel terror. They find themselves killing.
“I was impressed at the calmness with which I was shooting,” says one veteran, recalling himself gunning down Egyptian soldiers. “I felt like I was at an amusement park.”
The veterans also graphically describe multiple instances of Israeli soldiers — including themselves — shooting unarmed soldiers and civilians.
“Several times we captured guys, positioned them and just killed them,” one veteran recalls.
They also recall the shock and anguish of being forced to confront the humanity of the men they were killing. One tells of sorting through the papers of a dead Egyptian officer and finding a picture of his two children on the beach. Another recounts captured Egyptian soldiers pleading for water and mercy, and frightened teenage soldiers who soil their pants. One watches Arab families carrying their belongings from Jericho and thinks of his own family fleeing the Holocaust.
Even the recapture of the Old City of Jerusalem and the Western Wall evokes mixed feelings far from the iconic images of conquering soldiers weeping for joy. One participant says that when a shofar blows at the wall, it “sounded like a pig’s grunt.” Others are troubled by the sense that they are conquering not soldiers in the Old City but civilians in their homes.
“It wasn’t a freed city, it was an occupied city,” one says.
It is that sense of occupation and displacement of Palestinian natives — that Israel was not merely defending itself, but acting as a conqueror — that troubles the soldiers.
“I was convinced the war was just. It was about our existence,” one says. “But then it became something else.”
There is so much raw, varied and shocking material in the movie that parts can easily be wielded or attacked to serve particular political arguments. But the film is courageous enough to embrace contradictions and leave them unresolved. It offers an unflinching look at Israeli atrocities without being unpatriotic or anti-Zionist, recounting the horrors of the war without suggesting that Israel should have refused to fight it. It is critical of the Israeli occupation, yet doesn’t claim to offer answers.
“This film is about listening,” producer and co-writer Daniel Sivan puts it after the screening.
At the end of the film, Oz, now 78, is asked what he thinks of the tapes.
“I feel we spoke truth,” he replies.
http://www.haaretz.com/jewish/features/1.640216
S.Freud : Zeitgemäßes über Krieg und Tod – la guerre et sur la mort par Bernard UMBRECHT
Pourquoi surnomme-t-on les policiers des « poulets » ?- Adieu Poulet film
 Pourquoi surnomme-t-on les policiers des « poulets » ?
Pourquoi surnomme-t-on les policiers des « poulets » ?
Flic, poulet, poulaga, perdreau, schmidt, dek, lardu… Autant de sobriquets pour qualifier ces messieurs les policiers français. Mais pourquoi donc les affubler de surnoms pour la plupart tout droit sortis d’un poulailler ?
Les gardiens de la paix n’ont pas été surnommés « poulets » par hasard. Il faut remonter à l’année 1871 pour comprendre l’origine de ce qualificatif peu élogieux. Jules Ferry, à l’époque maire de la ville de Paris, met alors à disposition la caserne de la Cité à la préfecture de police pour y établir ses quartiers. La caserne ainsi allouée avait été bâtie sur l’ancien marché aux volailles… La marée chaussée se serait-elle fait plumer ? (Source)
- Crédits photo : Rama
http://lesavaistu.fr/surnomme-t-on-policiers-poulets/
SYNOPSIS
Lors d’une patrouille de nuit, en pleine campagne électorale, l’inspecteur Moitrié s’interpose courageusement dans une bagarre entre colleurs d’affiches. Son intervention paralyse un temps les antagonistes, mais l’un d’eux sort un revolver et tire froidement sur le policier. Avant de mourir, Moitrié révèle le nom du tueur : Portor, un repris de justice entré depuis au service de Lardatte, le candidat de droite, dont il assure la protection rapprochée. Le commissaire Verjeat, redoutable enquêteur au palmarès impressionnant, et son adjoint Lefèvre, de vingt ans son cadet, désinvolte, arrogant mais tout aussi efficace, sont chargés de l’enquête…
http://www.telerama.fr/cinema/films/adieu-poulet,4250.php























